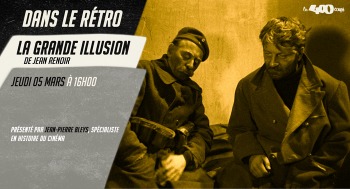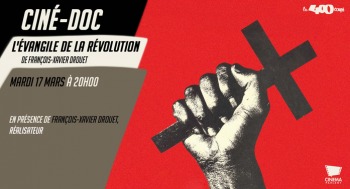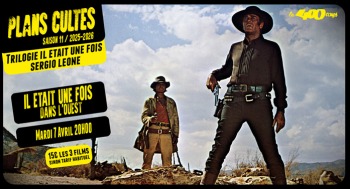ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS
Il fallait être un fou ou un génie pour traiter du thème de l’holocauste nucléaire sous la forme d’une farce absurde et caustique. Ça tombe bien, Stanley Kubrick était tout à la fois fou et génial, et Dr Folamour apparaît en bonne place dans la liste de ses nombreux chefs-d’?oeuvre. Et si chaque film du réalisateur de 2001 est unique, celui-ci l’est encore plus de par son ton (comique) et sa durée (1h35). Construit avec une minutie et un sens du rythme qui tutoient la perfection, Dr Folamour est toujours aussi drôle soixante ans après sa sortie. Kubrick orchestre avec brio la glissade progressive de son film dans l’absurde, jusqu’à atteindre le délire le plus total : le film devait à l’origine se clore sur une énorme bataille de tartes à la crème entre les différents généraux et politiques présents dans la salle de guerre. La scène a finalement été coupée au montage, mais la charge antimilitariste n’en est pas moins féroce.
Les personnages de Dr Folamour se répartissent en deux catégories. D’un côté les dirigeants, chez qui seul l’égoïsme peut espérer égaler l’incompétence. Tous apportent leur contribution à la catastrophe, que ce soit par paranoïa chez les généraux, mégalomanie chez les scientifiques ou immobilisme chez les politiques. Des défauts qui basculent dans l’absurdité dans le cas présent (le complot sur « la fluorisation de nos fluides corporels » est à hurler de rire, tout comme les « Mein Führer ! » du Dr Folamour), mais qui sur le fond ne sont pas si éloignés de la réalité. Ces dirigeants vivent complètement coupés de leurs troupes (troupeaux ?) qui leur obéissent pourtant sans discuter, qu’il s’agisse de mener l’assaut sur une base aérienne tenue par sa propre armée ou de larguer une bombe atomique. Ce sens du devoir est tellement ancré en eux qu’il s’applique même à la vie de tous les jours, comme le démontre la scène où un soldat zélé refuse de tirer sur un distributeur de Coca-Cola pour y récupérer de la monnaie car il s’agit d’une « propiété privée ». Dans le pessimisme kubrickien, les dirigeants décident, les soldats agissent, et plus personne ne prend la peine de réfléchir.
Dr Folamour est aussi une leçon de mise en scène. À la folie de ses personnages, Kubrick oppose une réalisation très sobre et quasi documentaire : cadrages statiques pour toutes les scènes de dialogues, caméra à l’épaule façon reportage de guerre lors de l’attaque de la base aérienne. Le décalage provient de la bande-son, qui porte en elle le regard critique de Kubrick, en passant en boucle une marche militaire entraînante lors des scènes situées dans le bombardier, ou via la chanson We’ll meet again du générique de fin. Le réalisme de la mise en scène fait ressortir les actions et attitudes des personnages et place les acteurs en première ligne. Ces derniers s’en tirent plus que bien : les seconds rôles Slim Pickens, Sterling Hayden et George C. Scott (dont chaque mimique aurait pu servir d’illustration à cet article) réalisent des performances comiques mémorables, et Peter Sellers dans trois rôles différents (dont l’halluciné et hallucinant Dr Folamour) est au-delà des superlatifs. Sa performance fait partie des mythes indémodables du cinéma, à l’image du film lui-même.
Erwan Desbois (Ecran Large)
Plans Cultes
mardi 15 octobre
2024 à 20h00
SOIRÉE PETER SELLERS
20h00 : DR. FOLAMOUR de Stanley Kubrick
22h00 : THE PARTY de Blake Edwards
Tarif spécial soirée : 11€ les 2 films sinon tarifs habituels
DR. FOLAMOUR
de Stanley Kubrick
avec Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden
USA - 1964 - 1h35 - VOST - Réédition - Version restaurée 4K
Le général Jack Ripper, convaincu que les Russes ont décidé d'empoisonner l'eau potable des États-Unis, lance sur l'URSS une offensive de bombardiers B-52 en ayant pris soin d'isoler la base aérienne de Burpelson du reste du monde. Pendant ce temps, Muffley, le Président des Etats-Unis, convoque l'état-major militaire dans la salle d'opérations du Pentagone et tente de rétablir la situation.
A PROPOS
Il fallait être un fou ou un génie pour traiter du thème de l’holocauste nucléaire sous la forme d’une farce absurde et caustique. Ça tombe bien, Stanley Kubrick était tout à la fois fou et génial, et Dr Folamour apparaît en bonne place dans la liste de ses nombreux chefs-d’?oeuvre. Et si chaque film du réalisateur de 2001 est unique, celui-ci l’est encore plus de par son ton (comique) et sa durée (1h35). Construit avec une minutie et un sens du rythme qui tutoient la perfection, Dr Folamour est toujours aussi drôle soixante ans après sa sortie. Kubrick orchestre avec brio la glissade progressive de son film dans l’absurde, jusqu’à atteindre le délire le plus total : le film devait à l’origine se clore sur une énorme bataille de tartes à la crème entre les différents généraux et politiques présents dans la salle de guerre. La scène a finalement été coupée au montage, mais la charge antimilitariste n’en est pas moins féroce.
Les personnages de Dr Folamour se répartissent en deux catégories. D’un côté les dirigeants, chez qui seul l’égoïsme peut espérer égaler l’incompétence. Tous apportent leur contribution à la catastrophe, que ce soit par paranoïa chez les généraux, mégalomanie chez les scientifiques ou immobilisme chez les politiques. Des défauts qui basculent dans l’absurdité dans le cas présent (le complot sur « la fluorisation de nos fluides corporels » est à hurler de rire, tout comme les « Mein Führer ! » du Dr Folamour), mais qui sur le fond ne sont pas si éloignés de la réalité. Ces dirigeants vivent complètement coupés de leurs troupes (troupeaux ?) qui leur obéissent pourtant sans discuter, qu’il s’agisse de mener l’assaut sur une base aérienne tenue par sa propre armée ou de larguer une bombe atomique. Ce sens du devoir est tellement ancré en eux qu’il s’applique même à la vie de tous les jours, comme le démontre la scène où un soldat zélé refuse de tirer sur un distributeur de Coca-Cola pour y récupérer de la monnaie car il s’agit d’une « propiété privée ». Dans le pessimisme kubrickien, les dirigeants décident, les soldats agissent, et plus personne ne prend la peine de réfléchir.
Dr Folamour est aussi une leçon de mise en scène. À la folie de ses personnages, Kubrick oppose une réalisation très sobre et quasi documentaire : cadrages statiques pour toutes les scènes de dialogues, caméra à l’épaule façon reportage de guerre lors de l’attaque de la base aérienne. Le décalage provient de la bande-son, qui porte en elle le regard critique de Kubrick, en passant en boucle une marche militaire entraînante lors des scènes situées dans le bombardier, ou via la chanson We’ll meet again du générique de fin. Le réalisme de la mise en scène fait ressortir les actions et attitudes des personnages et place les acteurs en première ligne. Ces derniers s’en tirent plus que bien : les seconds rôles Slim Pickens, Sterling Hayden et George C. Scott (dont chaque mimique aurait pu servir d’illustration à cet article) réalisent des performances comiques mémorables, et Peter Sellers dans trois rôles différents (dont l’halluciné et hallucinant Dr Folamour) est au-delà des superlatifs. Sa performance fait partie des mythes indémodables du cinéma, à l’image du film lui-même.
Erwan Desbois (Ecran Large)

A PROPOS
La Panthère rose, Diamants sur canapé ou encore Victor/Victoria : tous ces films sont le fruit de l’esprit de Blake Edwards, réalisateur plus sous-estimé que ses films cultes ne le laisseraient croire. En voici un autre où la fantaisie stylistique et le génie comique du cinéaste s’allient avec la fine démence de son acteur fétiche Peter Sellers. The Party est une coupe de Champagne où chaque bulle attend son tour pour revenir discrètement à la surface, avant d’éclater tels des feux d’artifices dans un palais en croissante euphorie. L’abus d’alcool peut être très bon pour la santé…
Un cascadeur indien, Hrundi V. Bakshi (Peter Sellers), se retrouve par un quiproquo à une soirée chez le producteur du film dont il vient de catastropher le tournage. Le résumé est bref, probablement à l’image du scénario qui fut donné par Blake Edwards et ses scénaristes au producteur. En effet, l’idée du film vint de sa scénographie, une incroyable villa hollywoodienne hyper-sophistiquée, sur laquelle baser un festival de gags. Il est facile de supposer que ledit producteur refusa la proposition, ce qui amena le cinéaste à se charger aussi de la production.
Et pour cause, car le décor en valait vraiment la peine. Tout y est : le lac intérieur, la piscine, le comptoir amovible s’allument, s’éteignent, s’illuminent, glissent, bougent en haut, en bas, à droite, à gauche… Seulement ce n’est pas la maîtresse de maison qui nous fait visiter les lieux, mais un drôle de guide qui de fait les découvre avec nous. Dès son entrée, Bakshi peut profiter du lac au-dessus duquel est posée une passerelle qui le mène au salon, pour rincer sa chaussure blanche qu’il a malencontreusement noyée dans la boue. Mais la chaussure glisse de son pied, flotte jusqu’à la limite du lac où l’attend une cascade qui la propulse dans un autre lac au beau milieu du salon où les convives prennent l’apéritif. C’est à l’aide d’une grande plante exotique que Bakshi va tenter d’attraper la chaussure, avant que la tige ne la catapulte entre les hors d’œuvre disposés sur le plateau d’un domestique qui passe sous les regards passifs des invités. Au bout de cinq minutes de périples, la chaussure se présente devant Bakshi qui peut enfin s’en emparer avec soulagement. Si cette description ne vaut pas le dixième de la scène vue à l’écran, elle donnera au moins le ton de la situation. Et ce n’est ni la première, ni la dernière des aventures de notre sympathique Indien.
Mais nous allons trop vite en besogne puisque les tout premiers plans nous annoncent autre chose. En effet, c’est un autre film qui ouvre The Party : on y voit des plaines ensablées, des charges de cavaleries, des coups de feux. Oui, cela ressemble bien à une sorte de Lawrence d’Arabie, mais non, il s’agit d’une mise en abyme. « Coupez ! » : crie le réalisateur avant que le producteur ne s’enferme dans la roulotte avec une blonde pulpeuse pendant la pause déjeuner : « Quarante minutes pour les techniciens ; une heure pour les acteurs. » C’est Hollywood sous toutes ses coutures. Ici l’envers du décor, là-bas dans les villas de Beverly Hills les soirées mondaines. En revanche, les gens sont les mêmes et finalement ce sont eux qui font Hollywood. En costume ou en robe de soirée, avec un accessoire ou avec une coupe de Champagne, les attitudes ne changent pas. Grand connaisseur, Edwards choisit d’illustrer ce microcosme à travers son passe-temps social plutôt que par la mise en abyme récurrente. Après tout, la villa est aussi digne d’un décor hollywoodien que Monument Valley ; les personnages feront le reste. PDG, entrepreneurs, producteurs, stars, starlettes, bourgeois, tous parlent d’investissements, pétrole, dépression nerveuse, et puis quoi d’autre au juste ?
Rien de spécial qui ait le mérite d’être relevé par le traitement sonore : tout est bruissement, comme si au fond ces discussions n’étaient pas de grande importance – à part lorsque Mr Clutterbuck doit sauver du clutter (trad. désordre) les peintures qui ont de la valeur. Probablement, nos jet-setters préfèrent écouter nonchalamment la douceur jazzy si propre aux soirées élégantes que se prendre trop au sérieux, puisque la bande originale ne cesse de couvrir les bavardages. Une invitation de la part du cinéaste à en faire de même dans la salle et l’on voudrait faire un monument à l’inégalable Henry Mancini, tellement on s’y laisse prendre. Pendant ce temps, là sur l’écran, les personnages sont des figurants qui déambulent dans une apathie qui est à la fois la leur et celle des villas hyper luxueuses où tout est parfait et rien ne dépasse. La caméra peut même s’immobiliser pour filmer en plan d’ensemble ces drôles de figurines si heureuses de se prêter au tableau de leur vie magnifique. Aucun effort n’est à fournir : le rose bonbon de la minijupe de mademoiselle et le diadème sur la choucroute de madame font l’affaire, sans parler du nœud papillon de monsieur. Comme pour la musique, encore une fois le détail est essentiel car il assimile ces gens et différencie Bakshi, mais surtout il compose.
Avant même d’entrer, la Mustang déglinguée du protagoniste se gare à côté des Cadillac et autres Chevrolet luisantes. Ensuite, ce sera au tour de ses souliers blancs comme neige, de son costume jaunâtre et de sa cravate pourpre. À l’intérieur, la palette des couleurs est parfaitement ajustée, prête à faire rejaillir la moindre bizarrerie qui sort du décor. Les jaunes, rouges, verts vifs ressemblent aux colorants d’un cocktail survitaminé dont Bakshi serait la cerise qui se distingue du verre. La séquence avec « Wyoming Bill » Kelso en est la preuve : accoutré dans sa panoplie de pseudo star de westerns de séries Z, il ne peut s’empêcher de voir en Bakshi l’indien à abattre. Si la séquence est traitée sous la forme du gag, elle en dit long sur la distance qui sépare Bakshi des archétypes américains. Le rappel incessant de sa nationalité reste le prix à payer pour communiquer avec les autres et il est condamné à jouer le différent jusqu’aux moindres particularités. De même, l’italienne à la longue chevelure rousse est voyante, alors que la jeune française qui attire Bakshi est si mignonne et discrète. Encore et toujours Hollywood, la terre où les clichés deviennent des rôles.
L’emploi de Bakshi est donc choisi d’emblée : il est l’homme-catastrophe sur le tournage et il le restera tout le long de la soirée. Cela dit, avec l’aide de son interprète, Blake Edwards parvient à éviter la surcharge systématique et à toucher ce qu’il y a de plus difficile dans le registre comique : l’élégance. Perdu au milieu de ce monde figé, il suffit que Peter Sellers bouge subtilement les yeux pour qu’on le remarque. Son comique n’est pas forcément ostentatoire en ce qu’il est plutôt le reflet d’une innocence embarrassée et mal à l’aise, mais toujours enthousiaste dans l’isolement. Le tandem formé avec le majordome soûl, dont les gaffes se font de plus en plus énormes, offre à la fois une complémentarité et une confrontation qui se termine par un match nul. Une escale de Bakshi aux toilettes, l’arrivée d’une horde de jeunes festifs avec un éléphant et la maison est inondée par un bain mousseux. Seules deux têtes reviennent à la surface, celles de Bakshi et de sa charmante demoiselle française flottant au-dessus de tout ce capharnaüm par la simple finesse génuine de leur bonheur.
Oui, The Party est terminé et la fin est presque romantique. Blake Edwards ne s’est pas contenté de nous donner envie d’aller à une grande soirée sur les hauteurs d’Hollywood pour y semer la pagaille. Faire le grand huit dans cette maison Disneyland ne lui a pas suffi. De notre côté, nous sommes songeurs après avoir vibré, nous sourions après avoir ri. Nous mettons un disque d’Henry Mancini et regardons nos murs, imaginant que tout à coup s’ouvrent une piscine avec des palmiers, des comptoirs à cocktails d’où nous sortirions une coupe de champagne pour revivre une autre party.
Oscar Duboy (Critikat)
THE PARTY
de Blake Edwards
avec Peter Sellers, Claudine Longet, J. Edward McKinley
USA - 1968 - 1h39 - VOST
Hrundi V. Bakshi, un acteur indien, est engagé par un studio hollywoodien pour interpréter un soldat indigène dans un remake de Gunga Din. Faisant preuve d'une terrible maladresse, il fait exploser un coûteux décor. Exaspéré, C.S. Divot, le producteur, demande à ce que le nom de Bakshi soit inscrit sur une liste noire. Mais suite à un quiproquo, le comédien indien se retrouve en fait invité à la soirée annuelle du studio.
https://www.splendor-films.com/films/the-party
A PROPOS
La Panthère rose, Diamants sur canapé ou encore Victor/Victoria : tous ces films sont le fruit de l’esprit de Blake Edwards, réalisateur plus sous-estimé que ses films cultes ne le laisseraient croire. En voici un autre où la fantaisie stylistique et le génie comique du cinéaste s’allient avec la fine démence de son acteur fétiche Peter Sellers. The Party est une coupe de Champagne où chaque bulle attend son tour pour revenir discrètement à la surface, avant d’éclater tels des feux d’artifices dans un palais en croissante euphorie. L’abus d’alcool peut être très bon pour la santé…
Un cascadeur indien, Hrundi V. Bakshi (Peter Sellers), se retrouve par un quiproquo à une soirée chez le producteur du film dont il vient de catastropher le tournage. Le résumé est bref, probablement à l’image du scénario qui fut donné par Blake Edwards et ses scénaristes au producteur. En effet, l’idée du film vint de sa scénographie, une incroyable villa hollywoodienne hyper-sophistiquée, sur laquelle baser un festival de gags. Il est facile de supposer que ledit producteur refusa la proposition, ce qui amena le cinéaste à se charger aussi de la production.
Et pour cause, car le décor en valait vraiment la peine. Tout y est : le lac intérieur, la piscine, le comptoir amovible s’allument, s’éteignent, s’illuminent, glissent, bougent en haut, en bas, à droite, à gauche… Seulement ce n’est pas la maîtresse de maison qui nous fait visiter les lieux, mais un drôle de guide qui de fait les découvre avec nous. Dès son entrée, Bakshi peut profiter du lac au-dessus duquel est posée une passerelle qui le mène au salon, pour rincer sa chaussure blanche qu’il a malencontreusement noyée dans la boue. Mais la chaussure glisse de son pied, flotte jusqu’à la limite du lac où l’attend une cascade qui la propulse dans un autre lac au beau milieu du salon où les convives prennent l’apéritif. C’est à l’aide d’une grande plante exotique que Bakshi va tenter d’attraper la chaussure, avant que la tige ne la catapulte entre les hors d’œuvre disposés sur le plateau d’un domestique qui passe sous les regards passifs des invités. Au bout de cinq minutes de périples, la chaussure se présente devant Bakshi qui peut enfin s’en emparer avec soulagement. Si cette description ne vaut pas le dixième de la scène vue à l’écran, elle donnera au moins le ton de la situation. Et ce n’est ni la première, ni la dernière des aventures de notre sympathique Indien.
Mais nous allons trop vite en besogne puisque les tout premiers plans nous annoncent autre chose. En effet, c’est un autre film qui ouvre The Party : on y voit des plaines ensablées, des charges de cavaleries, des coups de feux. Oui, cela ressemble bien à une sorte de Lawrence d’Arabie, mais non, il s’agit d’une mise en abyme. « Coupez ! » : crie le réalisateur avant que le producteur ne s’enferme dans la roulotte avec une blonde pulpeuse pendant la pause déjeuner : « Quarante minutes pour les techniciens ; une heure pour les acteurs. » C’est Hollywood sous toutes ses coutures. Ici l’envers du décor, là-bas dans les villas de Beverly Hills les soirées mondaines. En revanche, les gens sont les mêmes et finalement ce sont eux qui font Hollywood. En costume ou en robe de soirée, avec un accessoire ou avec une coupe de Champagne, les attitudes ne changent pas. Grand connaisseur, Edwards choisit d’illustrer ce microcosme à travers son passe-temps social plutôt que par la mise en abyme récurrente. Après tout, la villa est aussi digne d’un décor hollywoodien que Monument Valley ; les personnages feront le reste. PDG, entrepreneurs, producteurs, stars, starlettes, bourgeois, tous parlent d’investissements, pétrole, dépression nerveuse, et puis quoi d’autre au juste ?
Rien de spécial qui ait le mérite d’être relevé par le traitement sonore : tout est bruissement, comme si au fond ces discussions n’étaient pas de grande importance – à part lorsque Mr Clutterbuck doit sauver du clutter (trad. désordre) les peintures qui ont de la valeur. Probablement, nos jet-setters préfèrent écouter nonchalamment la douceur jazzy si propre aux soirées élégantes que se prendre trop au sérieux, puisque la bande originale ne cesse de couvrir les bavardages. Une invitation de la part du cinéaste à en faire de même dans la salle et l’on voudrait faire un monument à l’inégalable Henry Mancini, tellement on s’y laisse prendre. Pendant ce temps, là sur l’écran, les personnages sont des figurants qui déambulent dans une apathie qui est à la fois la leur et celle des villas hyper luxueuses où tout est parfait et rien ne dépasse. La caméra peut même s’immobiliser pour filmer en plan d’ensemble ces drôles de figurines si heureuses de se prêter au tableau de leur vie magnifique. Aucun effort n’est à fournir : le rose bonbon de la minijupe de mademoiselle et le diadème sur la choucroute de madame font l’affaire, sans parler du nœud papillon de monsieur. Comme pour la musique, encore une fois le détail est essentiel car il assimile ces gens et différencie Bakshi, mais surtout il compose.
Avant même d’entrer, la Mustang déglinguée du protagoniste se gare à côté des Cadillac et autres Chevrolet luisantes. Ensuite, ce sera au tour de ses souliers blancs comme neige, de son costume jaunâtre et de sa cravate pourpre. À l’intérieur, la palette des couleurs est parfaitement ajustée, prête à faire rejaillir la moindre bizarrerie qui sort du décor. Les jaunes, rouges, verts vifs ressemblent aux colorants d’un cocktail survitaminé dont Bakshi serait la cerise qui se distingue du verre. La séquence avec « Wyoming Bill » Kelso en est la preuve : accoutré dans sa panoplie de pseudo star de westerns de séries Z, il ne peut s’empêcher de voir en Bakshi l’indien à abattre. Si la séquence est traitée sous la forme du gag, elle en dit long sur la distance qui sépare Bakshi des archétypes américains. Le rappel incessant de sa nationalité reste le prix à payer pour communiquer avec les autres et il est condamné à jouer le différent jusqu’aux moindres particularités. De même, l’italienne à la longue chevelure rousse est voyante, alors que la jeune française qui attire Bakshi est si mignonne et discrète. Encore et toujours Hollywood, la terre où les clichés deviennent des rôles.
L’emploi de Bakshi est donc choisi d’emblée : il est l’homme-catastrophe sur le tournage et il le restera tout le long de la soirée. Cela dit, avec l’aide de son interprète, Blake Edwards parvient à éviter la surcharge systématique et à toucher ce qu’il y a de plus difficile dans le registre comique : l’élégance. Perdu au milieu de ce monde figé, il suffit que Peter Sellers bouge subtilement les yeux pour qu’on le remarque. Son comique n’est pas forcément ostentatoire en ce qu’il est plutôt le reflet d’une innocence embarrassée et mal à l’aise, mais toujours enthousiaste dans l’isolement. Le tandem formé avec le majordome soûl, dont les gaffes se font de plus en plus énormes, offre à la fois une complémentarité et une confrontation qui se termine par un match nul. Une escale de Bakshi aux toilettes, l’arrivée d’une horde de jeunes festifs avec un éléphant et la maison est inondée par un bain mousseux. Seules deux têtes reviennent à la surface, celles de Bakshi et de sa charmante demoiselle française flottant au-dessus de tout ce capharnaüm par la simple finesse génuine de leur bonheur.
Oui, The Party est terminé et la fin est presque romantique. Blake Edwards ne s’est pas contenté de nous donner envie d’aller à une grande soirée sur les hauteurs d’Hollywood pour y semer la pagaille. Faire le grand huit dans cette maison Disneyland ne lui a pas suffi. De notre côté, nous sommes songeurs après avoir vibré, nous sourions après avoir ri. Nous mettons un disque d’Henry Mancini et regardons nos murs, imaginant que tout à coup s’ouvrent une piscine avec des palmiers, des comptoirs à cocktails d’où nous sortirions une coupe de champagne pour revivre une autre party.
Oscar Duboy (Critikat)