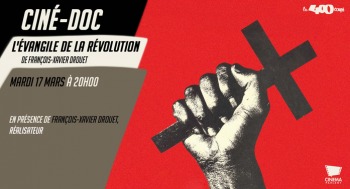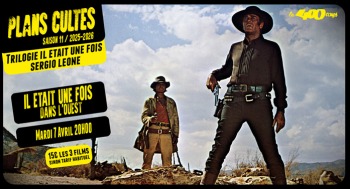ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS
Chaque génération possède sa comédie culte - qui parfois parvient à les traverser perpendiculairement - qui d’un Sacré Graal, qui d’un Père Noël est une ordure. Enfants de Canal +, drogués aux Police Squad (hilarante série éphémère qui a inspiré la séries des Y a-t-il un flic…), gavés au Saturday Night Live et sous perfusion de Monty Python, les Nuls, après avoir arrêté leurs pérégrinations télévisuelles, se sont dirigés naturellement vers le grand écran. Armés d’un puissant arsenal de rigolade massive dans l’écurie Canal, les trois rigolos montèrent un projet quasi-gagné d’avance. A l’époque intronisés leaders d’un humour multi-référenciel, ils piochèrent dans leur besace bardée de sketches et gags éprouvés lors de show tels que L’Emission ou le JTN, et écrivirent un script s’inspirant largement des thrillers américains (on pensera en particulier à Basic Instinct dont une scène entière est allégrement parodiée). Ensuite, ils engagèrent - avant que chacun d’entre eux ne mette la main à la caméra avec diverses fortunes - Alain Berberian - seul un humoriste de son rang pouvait être capable de faire Six Pack -, qui travaillait avec eux depuis ABCD Nuls, pour la réalisation. Le film atteint son statut culte dès la sortie, drainant son impressionnant lot de répliques cultes répétées à une époque où les Inconnus trustaient les cours de récrés après chacune de leur Télé des Inconnus – déclenchant une sorte d’éternel duel Rolling Stones / Beatles de l’humour français. Plus confidentiels, bien cachés sur la chaîne cryptée, les Nuls éclataient au jour brillant du cinéma. Plus de deux millions de spectateurs et une brillante carrière dans les vidéoclubs plus tard, La Cité de la peur, une comédie familiale et surtout l’un des films cultes des années 90.
Inutile de chercher un scénario cohérent ou une histoire valable, La Cité de la peur ne contient rien de tout cela. Que les plus de trente-cinq ans passent leur chemin, il ne leur parlera pas. Pris comme tel, La Cité de la peur n’est pas un véritable film, il ne ressemble qu’à un mince filin où sont emperlés les blagues les plus stupides, passant du running gag - "Attention chérie ça va couper" - aux vannes les plus graveleuses – "vous voulez du papier?". Et pourtant, la joyeuse virée fait mouche à chaque coup, dans chaque situation, pour chaque canular ou parodie. Parfaitement en phase avec leur public, jouant avec leurs attentes, leur humour et leur culture, les trois Nuls déploient les talents et les scènes qui s’empilent. Détails en avant et arrière-plans, non-sens et contre-allées, l’absurde jusqu’au-boutiste situé quelque part entre Goscinny et les stand-up comedians américains, ils tissent l’exemple parfait du film à revoir entre amis. A la fois capable de mettre la lumière sur l’œuvre de Dostoïevski (via les Frères Karamazov et la fameuse réplique: "aucun lien, je suis fils unique") et les gros films à la mode (la bande-annonce citait La Leçon de piano, Jurassic Park et Le Fugitif), La Cité de la peur misait avant tout sur un public jeune, ouvert et relativement cultivé/cinéphile. Tout l’art des Nuls fixé sur pellicule, ils parvenaient à conserver leur fraîcheur et leur vivacité quand d’autres s’avéraient être incapables de transformer leurs essais télévisuels. Et mieux que tout, rarement un film aura mieux tenu l’épreuve du temps et des visions successives. Des gags en béton armé, des situations cocasses et chamarrées, le film de Les Nuls contient plus de bêtises qu’un être humain peut en ingérer. Un concentré de répliques cultes, mieux qu’une poignée de main secrète générationnelle, La Cité de la peur, un art de vivre!
Nicolas Plaire (filmdeculte.com)
Plans Cultes
mardi 14 janvier
2020 à 19h45
LA CITÉ DE LA PEUR
de Alain Berbérian
avec Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia
FRANCE - 1994 - 1h40 - Réédition - Version restaurée 4K
Un mystérieux tueur communiste assassine à tour de rôle en plein Marché du Film à Cannes les projectionnistes d’un film de série Z dont il s’est inspiré. Sentant le coup de pub potentiel, l’attachée de presse tente de faire monter la sauce en faisant venir l’acteur principal – un abruti notoire – protégé par un garde du corps – un abruti notoire d’un autre genre. Dès cet instant le culte peut commencer.
A PROPOS
Chaque génération possède sa comédie culte - qui parfois parvient à les traverser perpendiculairement - qui d’un Sacré Graal, qui d’un Père Noël est une ordure. Enfants de Canal +, drogués aux Police Squad (hilarante série éphémère qui a inspiré la séries des Y a-t-il un flic…), gavés au Saturday Night Live et sous perfusion de Monty Python, les Nuls, après avoir arrêté leurs pérégrinations télévisuelles, se sont dirigés naturellement vers le grand écran. Armés d’un puissant arsenal de rigolade massive dans l’écurie Canal, les trois rigolos montèrent un projet quasi-gagné d’avance. A l’époque intronisés leaders d’un humour multi-référenciel, ils piochèrent dans leur besace bardée de sketches et gags éprouvés lors de show tels que L’Emission ou le JTN, et écrivirent un script s’inspirant largement des thrillers américains (on pensera en particulier à Basic Instinct dont une scène entière est allégrement parodiée). Ensuite, ils engagèrent - avant que chacun d’entre eux ne mette la main à la caméra avec diverses fortunes - Alain Berberian - seul un humoriste de son rang pouvait être capable de faire Six Pack -, qui travaillait avec eux depuis ABCD Nuls, pour la réalisation. Le film atteint son statut culte dès la sortie, drainant son impressionnant lot de répliques cultes répétées à une époque où les Inconnus trustaient les cours de récrés après chacune de leur Télé des Inconnus – déclenchant une sorte d’éternel duel Rolling Stones / Beatles de l’humour français. Plus confidentiels, bien cachés sur la chaîne cryptée, les Nuls éclataient au jour brillant du cinéma. Plus de deux millions de spectateurs et une brillante carrière dans les vidéoclubs plus tard, La Cité de la peur, une comédie familiale et surtout l’un des films cultes des années 90.
Inutile de chercher un scénario cohérent ou une histoire valable, La Cité de la peur ne contient rien de tout cela. Que les plus de trente-cinq ans passent leur chemin, il ne leur parlera pas. Pris comme tel, La Cité de la peur n’est pas un véritable film, il ne ressemble qu’à un mince filin où sont emperlés les blagues les plus stupides, passant du running gag - "Attention chérie ça va couper" - aux vannes les plus graveleuses – "vous voulez du papier?". Et pourtant, la joyeuse virée fait mouche à chaque coup, dans chaque situation, pour chaque canular ou parodie. Parfaitement en phase avec leur public, jouant avec leurs attentes, leur humour et leur culture, les trois Nuls déploient les talents et les scènes qui s’empilent. Détails en avant et arrière-plans, non-sens et contre-allées, l’absurde jusqu’au-boutiste situé quelque part entre Goscinny et les stand-up comedians américains, ils tissent l’exemple parfait du film à revoir entre amis. A la fois capable de mettre la lumière sur l’œuvre de Dostoïevski (via les Frères Karamazov et la fameuse réplique: "aucun lien, je suis fils unique") et les gros films à la mode (la bande-annonce citait La Leçon de piano, Jurassic Park et Le Fugitif), La Cité de la peur misait avant tout sur un public jeune, ouvert et relativement cultivé/cinéphile. Tout l’art des Nuls fixé sur pellicule, ils parvenaient à conserver leur fraîcheur et leur vivacité quand d’autres s’avéraient être incapables de transformer leurs essais télévisuels. Et mieux que tout, rarement un film aura mieux tenu l’épreuve du temps et des visions successives. Des gags en béton armé, des situations cocasses et chamarrées, le film de Les Nuls contient plus de bêtises qu’un être humain peut en ingérer. Un concentré de répliques cultes, mieux qu’une poignée de main secrète générationnelle, La Cité de la peur, un art de vivre!
Nicolas Plaire (filmdeculte.com)

A PROPOS
Tout le monde le sait: Jean Dujardin n’est pas l’acteur que l’on attend. Pourtant, jamais son jeu cabotin et outrancier n’avait été autant utilisé à bon escient. Autour de lui, le réalisateur Michel Hazanavicius a bâti un projet ambitieux et pourtant sans prétention, mariant exigence cinéphilique et comédie populaire. Une réussite inespérée.
Jusqu’ici, rien ne laissait présager qu’une grosse production française puisse un jour nous arracher un sourire. Après avoir été consternés devant Les Bronzés 3, La Doublure et autre Fauteuils d’orchestre, dont les seuls canevas scénaristiques ne tenaient qu’à des questions d’argent ou de réussite sociale, OSS 117 : Le Caire nid d’espions tombe à pic pour secouer le train-train insupportable du «rire» made in France. Et pourtant, cette dernière production, qui devrait sans mal attirer des millions de spectateurs, partait d’un très mauvais pied: la distribution, d’abord, avec en tête d’affiche Jean Dujardin, le nouveau golden boy d’un cinéma qui pense rentabilité avant créativité, puis un second rôle féminin tenu par une actrice qui n’a jamais vraiment fait ses preuves, Bérénice Béjo, à l’inverse d’Aure Atika; la réalisation et l’écriture, ensuite, supervisées par Michel Hazanavicius, coupable des scénarii de Delphine 1, Yvan 0 ou plus récemment du pitoyable Les Dalton.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, difficile d’imaginer qu’OSS 117 : Le Caire nid d’espions puisse être cette réussite dont on parle tant dans la presse nationale. Et pourtant, l’une des premières astuces du film est d’adopter la contrainte comme élément moteur. Réalisé – presque – comme une œuvre des années 1950, ce second long métrage de Michel Hazanavicius évite toutes les facilités dont nos comédies hexagonales s’abreuvent à outrance au point d’incarner le néant le plus édifiant. Même si on a tout de même droit à un festival Jean Dujardin en long, en large et en travers, le réalisateur ne se contente nullement de poser sa caméra en plan fixe et d’alterner les champs/contrechamps les plus médiocres. Pour cette adaptation d’une BD des années 1950 illustrant les prouesses d’un pitoyable agent secret, Michel Hazanavicius a choisi de rendre un hommage – trop rare aujourd’hui – aux films d’antan, notamment ceux de l’âge d’or d’Hollywood. Notons le très beau travail sur la couleur qui reproduit les contrastes du Technicolor et qui donne à cet épisode d’OSS 117 de lointains accents de La Mort aux trousses ou de L’Homme qui en savait trop. Le cinéma de studio et ses avions en maquette, ses voitures fixes derrière lesquelles défile un paysage exotique, renaît littéralement. L’art du faux est porté à son paroxysme.
Mais OSS 117 ne se contente nullement d’être un pastiche de chefs-d’œuvre pour la plupart inégalables. Le personnage titre n’a ni l’efficacité d’un James Bond, ni la classe d’un Cary Grant. Bien loin d’être une image flatteuse de l’homme occidental, OSS 117 est « typiquement français » – comme le lui fait remarquer Larmina (Bérénice Béjo) – c’est-à-dire à la fois suffisant, beauf, raciste au point d’avouer au porte-parole égyptien qu’il considère son peuple comme arriéré, en retard de plusieurs siècles sur la civilisation occidentale. Triste rappel d’un sentiment post-colonialiste qui perdure dans notre beau pays, édifiant reflet de l’intolérance et de l’incompréhension dont souffre aujourd’hui la religion musulmane. Sous ses airs de grande comédie populaire, OSS 117 n’est pas dénué de propos et ne se limite en aucun cas à provoquer l’éclat de rire de l’instant, le rire bête et régressif qui ne demande jamais au spectateur d’être plus qu’un consommateur de masse. Preuve en est ces flash-backs délirants sur l’amitié que vouait l’agent secret pour son ami assassiné. L’évidente homosexualité suggérée par les scènes rappelle les nombreux tabous que les réalisateurs des années 1950 devaient contourner avec génie pour ne jamais dénaturer leur film. Si Michel Hazanavicius n’a pas su convaincre lors de ses précédents projets cinématographiques, force est de reconnaître qu’il a grandi à bonne école. Collaborateur des Nuls, auteurs des meilleurs sketches pour les Guignols de l’Info, il a su concilier son talent pour l’écriture grinçante et son sens du gag le plus absurde, le plus incongru pour redorer le blason de la comédie de gauche, foncièrement progressiste. Si l’on frémit en écoutant l’infâme Veber citer les grandes comédies de Lubitsch, Hawks et autres Cukor, le cinéma de Michel Hazanavicius est bel et bien référencé, soucieux de revendiquer une histoire du cinéma dont il est aujourd’hui l’héritier.
Clément Graminiès (Critikat)
OSS 117 LE CAIRE NID D'ESPIONS
de Michel Hazanavicius
avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, Aure Atika
FRANCE - 2006 - 1h39
Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d'espions.
Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote contre tout le monde : Anglais, Français, Soviétiques, la famille du Roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les Aigles de Kheops, secte religieuse qui veut prendre le pouvoir. Le Président de la République Française, Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117.
A PROPOS
Tout le monde le sait: Jean Dujardin n’est pas l’acteur que l’on attend. Pourtant, jamais son jeu cabotin et outrancier n’avait été autant utilisé à bon escient. Autour de lui, le réalisateur Michel Hazanavicius a bâti un projet ambitieux et pourtant sans prétention, mariant exigence cinéphilique et comédie populaire. Une réussite inespérée.
Jusqu’ici, rien ne laissait présager qu’une grosse production française puisse un jour nous arracher un sourire. Après avoir été consternés devant Les Bronzés 3, La Doublure et autre Fauteuils d’orchestre, dont les seuls canevas scénaristiques ne tenaient qu’à des questions d’argent ou de réussite sociale, OSS 117 : Le Caire nid d’espions tombe à pic pour secouer le train-train insupportable du «rire» made in France. Et pourtant, cette dernière production, qui devrait sans mal attirer des millions de spectateurs, partait d’un très mauvais pied: la distribution, d’abord, avec en tête d’affiche Jean Dujardin, le nouveau golden boy d’un cinéma qui pense rentabilité avant créativité, puis un second rôle féminin tenu par une actrice qui n’a jamais vraiment fait ses preuves, Bérénice Béjo, à l’inverse d’Aure Atika; la réalisation et l’écriture, ensuite, supervisées par Michel Hazanavicius, coupable des scénarii de Delphine 1, Yvan 0 ou plus récemment du pitoyable Les Dalton.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, difficile d’imaginer qu’OSS 117 : Le Caire nid d’espions puisse être cette réussite dont on parle tant dans la presse nationale. Et pourtant, l’une des premières astuces du film est d’adopter la contrainte comme élément moteur. Réalisé – presque – comme une œuvre des années 1950, ce second long métrage de Michel Hazanavicius évite toutes les facilités dont nos comédies hexagonales s’abreuvent à outrance au point d’incarner le néant le plus édifiant. Même si on a tout de même droit à un festival Jean Dujardin en long, en large et en travers, le réalisateur ne se contente nullement de poser sa caméra en plan fixe et d’alterner les champs/contrechamps les plus médiocres. Pour cette adaptation d’une BD des années 1950 illustrant les prouesses d’un pitoyable agent secret, Michel Hazanavicius a choisi de rendre un hommage – trop rare aujourd’hui – aux films d’antan, notamment ceux de l’âge d’or d’Hollywood. Notons le très beau travail sur la couleur qui reproduit les contrastes du Technicolor et qui donne à cet épisode d’OSS 117 de lointains accents de La Mort aux trousses ou de L’Homme qui en savait trop. Le cinéma de studio et ses avions en maquette, ses voitures fixes derrière lesquelles défile un paysage exotique, renaît littéralement. L’art du faux est porté à son paroxysme.
Mais OSS 117 ne se contente nullement d’être un pastiche de chefs-d’œuvre pour la plupart inégalables. Le personnage titre n’a ni l’efficacité d’un James Bond, ni la classe d’un Cary Grant. Bien loin d’être une image flatteuse de l’homme occidental, OSS 117 est « typiquement français » – comme le lui fait remarquer Larmina (Bérénice Béjo) – c’est-à-dire à la fois suffisant, beauf, raciste au point d’avouer au porte-parole égyptien qu’il considère son peuple comme arriéré, en retard de plusieurs siècles sur la civilisation occidentale. Triste rappel d’un sentiment post-colonialiste qui perdure dans notre beau pays, édifiant reflet de l’intolérance et de l’incompréhension dont souffre aujourd’hui la religion musulmane. Sous ses airs de grande comédie populaire, OSS 117 n’est pas dénué de propos et ne se limite en aucun cas à provoquer l’éclat de rire de l’instant, le rire bête et régressif qui ne demande jamais au spectateur d’être plus qu’un consommateur de masse. Preuve en est ces flash-backs délirants sur l’amitié que vouait l’agent secret pour son ami assassiné. L’évidente homosexualité suggérée par les scènes rappelle les nombreux tabous que les réalisateurs des années 1950 devaient contourner avec génie pour ne jamais dénaturer leur film. Si Michel Hazanavicius n’a pas su convaincre lors de ses précédents projets cinématographiques, force est de reconnaître qu’il a grandi à bonne école. Collaborateur des Nuls, auteurs des meilleurs sketches pour les Guignols de l’Info, il a su concilier son talent pour l’écriture grinçante et son sens du gag le plus absurde, le plus incongru pour redorer le blason de la comédie de gauche, foncièrement progressiste. Si l’on frémit en écoutant l’infâme Veber citer les grandes comédies de Lubitsch, Hawks et autres Cukor, le cinéma de Michel Hazanavicius est bel et bien référencé, soucieux de revendiquer une histoire du cinéma dont il est aujourd’hui l’héritier.
Clément Graminiès (Critikat)