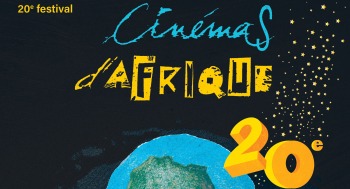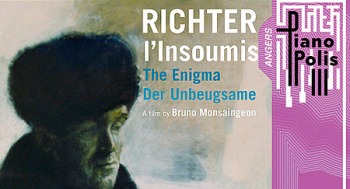ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS
Il y a des téléphones, des lignes électriques et les hommes d’affaire portent des costumes occidentaux : nous sommes bien à l’époque moderne, mais en dehors de ces quelques signes discrets, tout se passe comme si Mizoguchi niait la modernité pour mieux insister sur l’éternelle aliénation féminine. Certes, les dialogues regrettent discrètement l’ancien temps, c’est à dire l’avant-guerre puisque « les clients ne sont plus aussi exigeants », mais le manque de considération est le même, les geishas sont toujours au service exclusif de l’homme et, si leurs attributions n’inclut pas le sexe avec les clients, tout le film s’acharne à montrer à quel point leur choix est limité par des contraintes et des dépendances économiques. Dans une courte séquence, une apprentie s’informe des droits de l’homme et de la possibilité de porter plainte ; la réponse ne laisse aucun doute, la liberté des femmes n’est que mensonge. C’est l’un thème du film que cette différence entre l’affichage (la geisha représente la beauté pour les touristes) et la réalité plus sordide. Malgré ses réticences, Miyoharu sera obligée de céder ; elle le fait pour protéger Eiko, mais on sent à quel point cette protection est fragile et la fin, qui les voit se rendre à une « fête » ne résout rien…
Le film commence par un long travelling sur un paysage urbain qui se conclut sur une maison. À partir de là, Mizoguchi organise un enfermement visuel systématique : des intérieurs encombrés de voiles, de grilles, de portes et fenêtres à demi-ouvertes aux rues qui ne sont que d’obscurs passages couverts et oppressants, le cinéaste compose un monde clos dans lequel de constants sur-cadrages emprisonnent encore davantage les héroïnes. De même les tient-il à distance, sans gros plans : c’est que l’image comme les dialogues reposent sur la distance et, en fin de compte, l’extrême pudeur. Victimes, les femmes le sont sans aucun doute ; mais, ce sont les hommes qui se lamentent, à l’image du père d’Eiko, qui apparaît trois fois, gémissant, évoquant son suicide pour apitoyer. Au comble de la misère et de l’incertitude, Miyoharu parvient encore à lui donner des objets de valeur. Lâche et méprisable, il incarne l’égoïsme masculin, auquel s’opposent la détermination et le courage féminin. Malgré Okimi, personnage plutôt négatif, c’est bien du côté des femmes que penche Mizoguchi et son indignation se fait dans le murmure, la retenue : elle n’en est que plus forte tant la cruauté s’étale et corrode l’ensemble d’une société. À cet égard le thème de la corruption met au même plan un réfrigérateur et la geisha, tous deux objets servant à conquérir des marchés dans un capitalisme aveugle et froid.
Évidemment, on retrouve dans ces Musiciens de Gion non seulement la thématique du grand cinéaste, mais aussi ce style inimitable de plans longs, de profondeur de champ, d’utilisation du décor ou de cadrages millimétrés. Tout ici fait sens, voir la magnifique séquence dans laquelle Miyoharu revient avec des cadeaux ; Eiko comprend qu’elle a cédé, ce qu’elle nie mollement avant de reconnaître. Admirables ici, non seulement la scénographie, le découpage, mais également le jeu des regards : la jeune fille refuse de regarder son aînée et toute la scène devient en quelque sorte la conquête d’un regard qui vaudra acceptation.
Moins réputé que d’autres chefs-d’œuvre, Les musiciens de Gion les rejoint dans la même mise en scène délicate et incroyablement soignée, comme dans la thématique (voir Les sœurs de Gion, film « cousin » de celui-ci, ou La rue de la honte, entre autres). C’est toute la cohérence de Mizoguchi que de traiter inlassablement les mêmes préoccupations en de subtiles variations, sans se répéter ni lasser. Ici encore, comme un miracle, avec une histoire typiquement japonaise, le réalisateur atteint l’émotion poignante et universelle, tout en refusant le pathos ou l’exhibition. On est constamment dans la retenue, qui n’en est que plus désolante. Du grand art, tout simplement.
François Bonini (avoiralire.com)
Ciné classique
mardi 30 mai
2023 à 20h00
présenté par Fabrice Rubiella, conservateur et commissaire de l'exposition Séduction au musée Pincé
Soirée organisée dans le cadre de l'Exposition Séduction au musée Pincé
LES MUSICIENS DE GION
de Kenji Mizoguchi
avec Masayuki Mori, Machiko Kyo, Kinuyo Tanaka
JAPON - 1953 - 1h25 - VOST - Version restaurée 2K
https://capricci.fr/wordpress/product/retrospective-kenji-mizoguchi-en-8-films/
A PROPOS
Il y a des téléphones, des lignes électriques et les hommes d’affaire portent des costumes occidentaux : nous sommes bien à l’époque moderne, mais en dehors de ces quelques signes discrets, tout se passe comme si Mizoguchi niait la modernité pour mieux insister sur l’éternelle aliénation féminine. Certes, les dialogues regrettent discrètement l’ancien temps, c’est à dire l’avant-guerre puisque « les clients ne sont plus aussi exigeants », mais le manque de considération est le même, les geishas sont toujours au service exclusif de l’homme et, si leurs attributions n’inclut pas le sexe avec les clients, tout le film s’acharne à montrer à quel point leur choix est limité par des contraintes et des dépendances économiques. Dans une courte séquence, une apprentie s’informe des droits de l’homme et de la possibilité de porter plainte ; la réponse ne laisse aucun doute, la liberté des femmes n’est que mensonge. C’est l’un thème du film que cette différence entre l’affichage (la geisha représente la beauté pour les touristes) et la réalité plus sordide. Malgré ses réticences, Miyoharu sera obligée de céder ; elle le fait pour protéger Eiko, mais on sent à quel point cette protection est fragile et la fin, qui les voit se rendre à une « fête » ne résout rien…
Le film commence par un long travelling sur un paysage urbain qui se conclut sur une maison. À partir de là, Mizoguchi organise un enfermement visuel systématique : des intérieurs encombrés de voiles, de grilles, de portes et fenêtres à demi-ouvertes aux rues qui ne sont que d’obscurs passages couverts et oppressants, le cinéaste compose un monde clos dans lequel de constants sur-cadrages emprisonnent encore davantage les héroïnes. De même les tient-il à distance, sans gros plans : c’est que l’image comme les dialogues reposent sur la distance et, en fin de compte, l’extrême pudeur. Victimes, les femmes le sont sans aucun doute ; mais, ce sont les hommes qui se lamentent, à l’image du père d’Eiko, qui apparaît trois fois, gémissant, évoquant son suicide pour apitoyer. Au comble de la misère et de l’incertitude, Miyoharu parvient encore à lui donner des objets de valeur. Lâche et méprisable, il incarne l’égoïsme masculin, auquel s’opposent la détermination et le courage féminin. Malgré Okimi, personnage plutôt négatif, c’est bien du côté des femmes que penche Mizoguchi et son indignation se fait dans le murmure, la retenue : elle n’en est que plus forte tant la cruauté s’étale et corrode l’ensemble d’une société. À cet égard le thème de la corruption met au même plan un réfrigérateur et la geisha, tous deux objets servant à conquérir des marchés dans un capitalisme aveugle et froid.
Évidemment, on retrouve dans ces Musiciens de Gion non seulement la thématique du grand cinéaste, mais aussi ce style inimitable de plans longs, de profondeur de champ, d’utilisation du décor ou de cadrages millimétrés. Tout ici fait sens, voir la magnifique séquence dans laquelle Miyoharu revient avec des cadeaux ; Eiko comprend qu’elle a cédé, ce qu’elle nie mollement avant de reconnaître. Admirables ici, non seulement la scénographie, le découpage, mais également le jeu des regards : la jeune fille refuse de regarder son aînée et toute la scène devient en quelque sorte la conquête d’un regard qui vaudra acceptation.
Moins réputé que d’autres chefs-d’œuvre, Les musiciens de Gion les rejoint dans la même mise en scène délicate et incroyablement soignée, comme dans la thématique (voir Les sœurs de Gion, film « cousin » de celui-ci, ou La rue de la honte, entre autres). C’est toute la cohérence de Mizoguchi que de traiter inlassablement les mêmes préoccupations en de subtiles variations, sans se répéter ni lasser. Ici encore, comme un miracle, avec une histoire typiquement japonaise, le réalisateur atteint l’émotion poignante et universelle, tout en refusant le pathos ou l’exhibition. On est constamment dans la retenue, qui n’en est que plus désolante. Du grand art, tout simplement.
François Bonini (avoiralire.com)