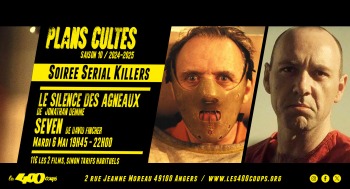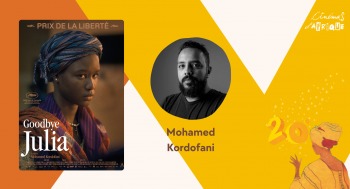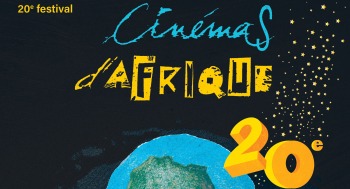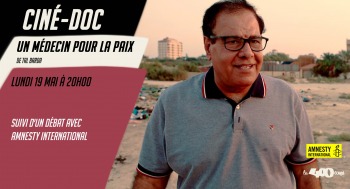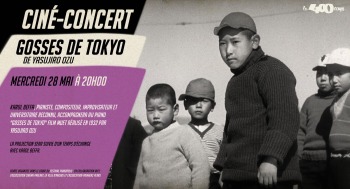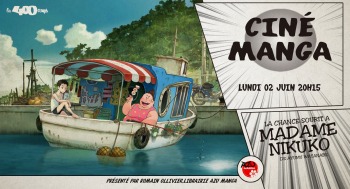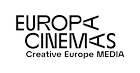ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS
«Même la pluie» relate le tournage chaotique d’un film en Bolivie, marqué par la colère des figurants indigènes exploités.
Le film dans le film et son corollaire, la mise en abîme, constituent un exercice acrobatique où la gamelle n’est jamais très loin. Surtout quand le sujet est, comme ici, pavé de bonnes intentions. Or, Même la pluie s’en tire avec les honneurs et même un peu mieux que cela. Le cinquième long métrage de la réalisatrice Icíar Bollaín prend pour prétexte le tournage d’une production espagnole consacrée à la vie de Bartolomé de Las Casas, colonisateur contemporain de Christophe Colomb et qui devint moine franciscain pour défendre les autochtones massacrés par milliers par les conquistadors.
Sur le même sujet
Le tournage a lieu dans une zone rurale de Bolivie qui, outre ses paysages grandioses, présente l’avantage de fournir des figurants crédibles et surtout très bon marché. Or, ces mêmes figurants indiens sont en pleine insurrection, luttant contre une décision de privatisation de l’eau accentuant encore, si une telle chose est possible, la dureté de leur condition. Ces épisodes de la guerre de l’eau en Bolivie ne sont pas issus de l’imagination du scénariste du film Paul Laverty, vieux complice de Ken Loach.
En 2000, l’agglomération de Cochabamba, troisième ville de Bolivie, a été le théâtre d’affrontements violents, se soldant par d’innombrables blessés et une dizaine de morts, sans compter les centaines d’arrestations et de passages à tabac.
La parabole semble un peu pesante à l’écrit, elle ne l’est pas à l’écran grâce à une efficace alternance des différents espaces temps. En mixant sans transition et dans la continuité du récit, les scènes de tournage dans un pays au bord de l’explosion et la fiction en costumes, la superposition ne souffre d’aucune lourdeur. Car, si l’Occident a peut-être changé, faisant volontiers acte de contrition à l’égard des peuples qu’il a jadis réduits en esclavage, le sort de leurs descendants condamnés à une misère éternelle reste lui immuable. Et Même la pluie pose une question : à quoi riment au juste le cinéma et ces indignations de pacotille qui ne serviront qu’à donner bonne conscience à un public conquis d’avance ? Pour l’équipe de cinéma, un choix s’impose : continuer à tourner un film acquis à la cause des Indiens morts il y a cinq siècles ou prendre la défense des vivants. Le spectateur, qui assiste au résultat, connaît la réponse.
Pendant la quasi-totalité de Même la pluie, cette aptitude à s’inscrire lui-même dans le schéma critique et donc, à se mettre en danger, tient la route. On peut se montrer plus réticent à suivre la bascule crânement mélo de sa dernière partie, à travers notamment la rédemption du plus salaud d’entre tous. Mais après tout, il s’agirait de ne pas oublier que nous sommes au cinéma.
Bruno ICHER (Libération)
Soirée rencontre
jeudi 10 octobre
2013 à 20h15
Cité d'eau édition 2013
Rencontre avec Philippe Piau et la Direction
Eau et Assainissement d'Angers Loire Métropole.
Soirée organisée en collaboration avec la Maison de l’environnement, Angers Loire
Métropole et la Ville d'Angers
MÊME LA PLUIE
de Icíar Bollaín
avec Luis Tosar, Gael Garcia Bernal, Juan Carlos Aduviri
ESPAGNE - FRANCE - MEXIQUE - 2010 - 1h43 - version originale sous titrée
Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor somptueux des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Les budgets de production sont serrés et Costa, le producteur, se félicite de pouvoir employer des comédiens et des figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt le tournage est interrompu par la révolte menée par l'un des principaux figurants contre le pouvoir en place qui souhaite privatiser l'accès à l'eau courante. Costa et Sebastian se trouvent malgré eux emportés dans cette lutte pour la survie d'un peuple démuni. Ils devront choisir entre soutenir la cause de la population et la poursuite de leur propre entreprise sur laquelle ils ont tout misé. Ce combat pour la justice va bouleverser leur existence.
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/arts_culture/cinema/tambien.php?parent=81
A PROPOS
«Même la pluie» relate le tournage chaotique d’un film en Bolivie, marqué par la colère des figurants indigènes exploités.
Le film dans le film et son corollaire, la mise en abîme, constituent un exercice acrobatique où la gamelle n’est jamais très loin. Surtout quand le sujet est, comme ici, pavé de bonnes intentions. Or, Même la pluie s’en tire avec les honneurs et même un peu mieux que cela. Le cinquième long métrage de la réalisatrice Icíar Bollaín prend pour prétexte le tournage d’une production espagnole consacrée à la vie de Bartolomé de Las Casas, colonisateur contemporain de Christophe Colomb et qui devint moine franciscain pour défendre les autochtones massacrés par milliers par les conquistadors.
Sur le même sujet
Le tournage a lieu dans une zone rurale de Bolivie qui, outre ses paysages grandioses, présente l’avantage de fournir des figurants crédibles et surtout très bon marché. Or, ces mêmes figurants indiens sont en pleine insurrection, luttant contre une décision de privatisation de l’eau accentuant encore, si une telle chose est possible, la dureté de leur condition. Ces épisodes de la guerre de l’eau en Bolivie ne sont pas issus de l’imagination du scénariste du film Paul Laverty, vieux complice de Ken Loach.
En 2000, l’agglomération de Cochabamba, troisième ville de Bolivie, a été le théâtre d’affrontements violents, se soldant par d’innombrables blessés et une dizaine de morts, sans compter les centaines d’arrestations et de passages à tabac.
La parabole semble un peu pesante à l’écrit, elle ne l’est pas à l’écran grâce à une efficace alternance des différents espaces temps. En mixant sans transition et dans la continuité du récit, les scènes de tournage dans un pays au bord de l’explosion et la fiction en costumes, la superposition ne souffre d’aucune lourdeur. Car, si l’Occident a peut-être changé, faisant volontiers acte de contrition à l’égard des peuples qu’il a jadis réduits en esclavage, le sort de leurs descendants condamnés à une misère éternelle reste lui immuable. Et Même la pluie pose une question : à quoi riment au juste le cinéma et ces indignations de pacotille qui ne serviront qu’à donner bonne conscience à un public conquis d’avance ? Pour l’équipe de cinéma, un choix s’impose : continuer à tourner un film acquis à la cause des Indiens morts il y a cinq siècles ou prendre la défense des vivants. Le spectateur, qui assiste au résultat, connaît la réponse.
Pendant la quasi-totalité de Même la pluie, cette aptitude à s’inscrire lui-même dans le schéma critique et donc, à se mettre en danger, tient la route. On peut se montrer plus réticent à suivre la bascule crânement mélo de sa dernière partie, à travers notamment la rédemption du plus salaud d’entre tous. Mais après tout, il s’agirait de ne pas oublier que nous sommes au cinéma.
Bruno ICHER (Libération)