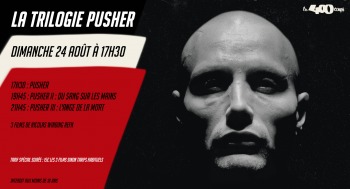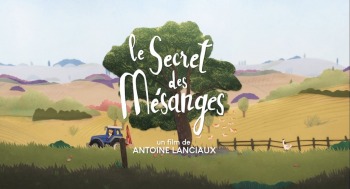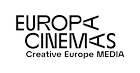ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS
Un Toy Story à la belge où tout est chamboulé : la logique, l’échelle, le yin, le yang, la vie des animaux. Virtuose et loufoque.
Comment faire son propre Toy Story quand on est belge et qu’on n’est pas riche comme Picsou ou Pixar ? En jouant sur sa pauvreté de moyens et en utilisant des figurines rudimentaires en plastique. Poussant à leur paroxysme les jeux et l’imaginaire d’un enfant de 10 ans, Stéphane Aubier et Vincent Patar ne connaissent aucune limite et livrent avec Panique au village le film d’animation européen le plus décoiffant depuis Wallace et Gromit. C’est l’histoire de Cow-Boy et Indien qui, désirant offrir un barbecue à Cheval pour son anniversaire, commandent des briques pour le fabriquer. Au lieu de quelques briques, on leur en livre une quantité astronomique. Sur ce, des Atlantes viennent voler leurs murs… La poursuite des malfaiteurs mène nos héros sous la mer puis dans la neige. De retour à la maison, assiégés par les Atlantes, ils recourront à l’arme fatale : le lancer de cochons…
En amont de cette comédie zinzin, il y a un long travail de maturation de près de vingt ans, lors desquels le tandem a exploré deux veines parallèles dans ses courts métrages : celle du dessin animé traditionnel pour Pic Pic André, et celle de l’animation en volume avec Panique au village. Ces films ont été diffusés à la télé, mais aussi au cinéma.
En 2001, un film de Patar et Aubier sortit en salle sous le titre Pic Pic André (et leurs amis) : ce florilège comprenait, outre les aventures du cochon Pic Pic et de son comparse le cheval André, celles des Baltus, une famille de branques totaux, exécutées avec des photos découpées – technique fruste que les réalisateurs ont délaissée depuis (sans doute parce qu’elle est limitée).
Panique au village, sans doute la série la plus développée d’Aubier et Patar, a pour point commun un même décor de collines, où vivent d’un côté Cheval, Indien et Cow-Boy, et de l’autre, dans une maison mitoyenne, le fermier Steven, qui parle en hurlant, et sa femme Janine. Sur la route, entre les deux, Gendarme fait la circulation et un peu n’importe quoi. Le scénario du long est le prolongement d’un épisode de Panique intitulé “Les Voleurs de cartes”, où les héros étaient confrontés aux habitants de l’Atlantide.
La force de la série, et donc du film, c’est sa littéralité tautologique (Cheval est bêtement un cheval). Aubier et Patar ont non seulement fait de la pauvreté de moyens un atout, mais aussi une image de marque. Ainsi, les personnages qui, au départ, étaient de véritables jouets, à peine (voire pas du tout) articulés – ils avançaient en pivotant sur eux-mêmes –, ont certes gagné en souplesse mais ils ont conservé leur apparence de produits industriels en plastique moulé affublés de leur socle vert. Les réalisateurs jouent ainsi des défauts et de la médiocrité artistique des objets. De même, ils n’adaptent pas tous les décors et accessoires aux personnages. Ils jouent en virtuoses de la disparité des échelles – autre preuve de leur sens de l’absurde –, ou plutôt ils utilisent tels quels des éléments hétéroclites, sans se soucier de l’incongruité de leur format. Voir le séchoir à cheveux grandeur nature avec lequel Indien sèche les plumes de sa coiffure (traitées comme des cheveux), ou le gag récurrent des tartines réelles (en vrai pain) de Steven (donc gigantesques par rapport à lui). La drôlerie provient de ces approximations, mais aussi des voix, plus loufoques les unes que les autres, qui font la part belle à l’accent belge. Il y a enfin le récit lui-même, complètement azimuté, qui obéit à la logique du rêve. Celle-ci consiste à créer des principes de cause à effet entre des choses qui n’ont aucun rapport évident. D’où la supériorité du rêve, capable de formuler des associations d’idées inconcevables pour l’esprit conscient, paralysé par des schémas stéréotypés. C’est donc un des principes du surréalisme que Panique au village applique génialement et sans prétention aucune
Vincent Ostria (Les Inrocks)
Suivez la route de l'animation
vendredi 10 octobre
2014 à 20h15
précédé du court-métrage d'un résident à l'Abbaye de Fontevraud
Séance présentée par Alexis Hunot, spécialiste du cinéma d'animation
dans le cadre de SUIVEZ LA ROUTE DE L'ANIMATION
Séance organisée dans le cadre de SUIVEZ LA ROUTE DE L'ANIMATION en collaboration avec l'Abbaye de Fontevraud
PANIQUE AU VILLAGE
de Vincent Patar & Stéphane Aubier
Film d'animation
Belgique - 1h16 - 2009
Cowboy et Indien, frères ennemis de longue date, fêtent l'anniversaire de Cheval, ami fidèle et âme morale du village. Ils ont prévu de lui offrir un magnifique barbecue fait main lors de la fête surprise organisée en son honneur. Malheureusement une faute de frappe lors de la commande de briques multiplie le nombre de celles-ci par un milliard. D'abord dissimulées aux yeux de tous, elles provoquent la nuit venant un véritable cataclysme dans le village qui détruit au passage la maison de Cheval, Indien et Cowboy. Reconstruite aussitôt, ses murs disparaissent mystérieusement la nuit. Les trois héros se lancent alors à la poursuite d'étranges créatures sous-marines, les Atlantes, traîtres espiègles et voleurs de murs à leurs heures. Sur leur chemin, un ours en colère, trois scientifiques fous et une matriarche psychopathe...
http://www.paniqueauvillage.com/
A PROPOS
Un Toy Story à la belge où tout est chamboulé : la logique, l’échelle, le yin, le yang, la vie des animaux. Virtuose et loufoque.
Comment faire son propre Toy Story quand on est belge et qu’on n’est pas riche comme Picsou ou Pixar ? En jouant sur sa pauvreté de moyens et en utilisant des figurines rudimentaires en plastique. Poussant à leur paroxysme les jeux et l’imaginaire d’un enfant de 10 ans, Stéphane Aubier et Vincent Patar ne connaissent aucune limite et livrent avec Panique au village le film d’animation européen le plus décoiffant depuis Wallace et Gromit. C’est l’histoire de Cow-Boy et Indien qui, désirant offrir un barbecue à Cheval pour son anniversaire, commandent des briques pour le fabriquer. Au lieu de quelques briques, on leur en livre une quantité astronomique. Sur ce, des Atlantes viennent voler leurs murs… La poursuite des malfaiteurs mène nos héros sous la mer puis dans la neige. De retour à la maison, assiégés par les Atlantes, ils recourront à l’arme fatale : le lancer de cochons…
En amont de cette comédie zinzin, il y a un long travail de maturation de près de vingt ans, lors desquels le tandem a exploré deux veines parallèles dans ses courts métrages : celle du dessin animé traditionnel pour Pic Pic André, et celle de l’animation en volume avec Panique au village. Ces films ont été diffusés à la télé, mais aussi au cinéma.
En 2001, un film de Patar et Aubier sortit en salle sous le titre Pic Pic André (et leurs amis) : ce florilège comprenait, outre les aventures du cochon Pic Pic et de son comparse le cheval André, celles des Baltus, une famille de branques totaux, exécutées avec des photos découpées – technique fruste que les réalisateurs ont délaissée depuis (sans doute parce qu’elle est limitée).
Panique au village, sans doute la série la plus développée d’Aubier et Patar, a pour point commun un même décor de collines, où vivent d’un côté Cheval, Indien et Cow-Boy, et de l’autre, dans une maison mitoyenne, le fermier Steven, qui parle en hurlant, et sa femme Janine. Sur la route, entre les deux, Gendarme fait la circulation et un peu n’importe quoi. Le scénario du long est le prolongement d’un épisode de Panique intitulé “Les Voleurs de cartes”, où les héros étaient confrontés aux habitants de l’Atlantide.
La force de la série, et donc du film, c’est sa littéralité tautologique (Cheval est bêtement un cheval). Aubier et Patar ont non seulement fait de la pauvreté de moyens un atout, mais aussi une image de marque. Ainsi, les personnages qui, au départ, étaient de véritables jouets, à peine (voire pas du tout) articulés – ils avançaient en pivotant sur eux-mêmes –, ont certes gagné en souplesse mais ils ont conservé leur apparence de produits industriels en plastique moulé affublés de leur socle vert. Les réalisateurs jouent ainsi des défauts et de la médiocrité artistique des objets. De même, ils n’adaptent pas tous les décors et accessoires aux personnages. Ils jouent en virtuoses de la disparité des échelles – autre preuve de leur sens de l’absurde –, ou plutôt ils utilisent tels quels des éléments hétéroclites, sans se soucier de l’incongruité de leur format. Voir le séchoir à cheveux grandeur nature avec lequel Indien sèche les plumes de sa coiffure (traitées comme des cheveux), ou le gag récurrent des tartines réelles (en vrai pain) de Steven (donc gigantesques par rapport à lui). La drôlerie provient de ces approximations, mais aussi des voix, plus loufoques les unes que les autres, qui font la part belle à l’accent belge. Il y a enfin le récit lui-même, complètement azimuté, qui obéit à la logique du rêve. Celle-ci consiste à créer des principes de cause à effet entre des choses qui n’ont aucun rapport évident. D’où la supériorité du rêve, capable de formuler des associations d’idées inconcevables pour l’esprit conscient, paralysé par des schémas stéréotypés. C’est donc un des principes du surréalisme que Panique au village applique génialement et sans prétention aucune
Vincent Ostria (Les Inrocks)