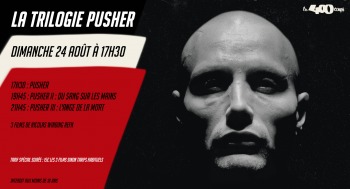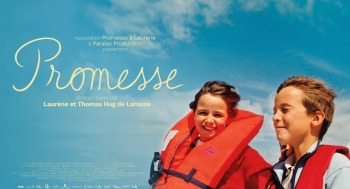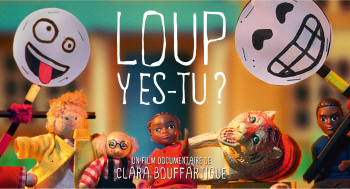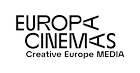ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS
Ce film qui a avec le temps mis tout le monde d’accord au sujet de Sergio Leone – même ceux qui ne sauraient en citer que des notes d’harmonica –, ce classique qui marche entre les tombes des classiques, son auteur aurait peut-être voulu ne pas devoir le faire. L’Italien pensait bien en avoir fini avec le western, genre qu’il avait enflé, étiré, dépouillé avec sa trilogie de l’« Homme Sans Nom » (ou « du Dollar »). Mais voilà : avant qu’il ne puisse concrétiser ses envies d’ailleurs (interroger d’autres mythologies : il n’aurait, en vérité, que ses trois Il était une fois pour le faire), les studios américains qui, ironiquement, voyaient en lui la relève du classicisme auquel il n’avait cessé de se confronter, insistèrent pour que son Cinémascope furieux fasse de nouveau parler la poudre dans son Far West à la bolognaise. Qu’à cela ne tienne : au lieu de la redite attendue des transgressions facétieuses à l’œuvre dans ses films précédents, Il était une fois dans l’Ouest, moins ricanant et plus sentimental, serait son film idéal pour tourner définitivement la page.
Au bout de treize interminables minutes d’attente où les bruits ambiants forment un orchestre pour combler le silence aussi lourd que le soleil, trois hommes – dont deux têtes familières du western classique, Woody Strode et Jack Elam – se font dessouder sur un quai de gare par un Charles Bronson maniaque de l’harmonica, lui-même passé des sept gentils Mercenaires aux Douze Salopards. Le film vient à peine de commencer. Nouvel acte de défi, voire de guerre, envers le vénérable genre ? Pas vraiment, comprend-on rapidement : Leone, pourtant volontiers sacrilège, n’est pas du genre à s’acharner sur un cadavre. Le décès de l’ancêtre est déjà notifié, ne fût-ce que par le défilé d’allusions plus ou moins directes à d’illustres représentants comme La Prisonnière du désert, Le train sifflera trois fois ou 3h10 pour Yuma. Coécrit avec Leone par deux critiques de cinéma et futurs réalisateurs cinéphiles, Argento et Bertolucci, Il était une fois dans l’Ouest aura contribué à introduire à Hollywood l’idée, apparue avec la Nouvelle Vague française, de films qui évoqueraient d’autres films, qui leur rendraient hommage, qui surtout prendraient acte de leur statut d’œuvres du passé tout en attestant leur héritage.
Ainsi le western d’antan, qui commençait à s’éteindre au moment où Ford réalisait L’Homme qui tua Liberty Valance en 1962, se trouve bien six pieds sous terre quand Leone s’intéresse de nouveau à lui en 1968 – le meilleur indice n’en reste-t-il pas les appels répétés de Hollywood à l’Italien pour prendre la relève dans l’espoir de réincarner le défunt ? Les traces qui en subsistent pourrissent et exhibent leur corruption à ciel ouvert (à l’image d’un Henry Fonda aux yeux bleus duquel on donnait jadis le Bon Dieu sans confession, devenu ici une ordure indéfendable que la caméra révèle de façon théâtrale et implacable), vestiges que l’obsessionnelle quête de vengeance de Bronson, l’« Harmonica » hanté par son héritage, n’a pour but, au fond, que de balayer avant de passer enfin à autre chose. Seulement, ce vengeur solitaire n’en est pas moins lui-même un autre vestige usé des mythes et archétypes passés, et dès lors se trouve lui aussi appelé à disparaître une fois son œuvre achevée et sa pulsion de mort satisfaite. Tout comme le hors-la-loi joué par Jason Robards, impliqué malgré lui dans le contentieux entre Bronson et Fonda : sans doute le personnage le plus « leonien » du lot (proche des rôles de bandit sale, vulgaire et un peu malmené par les événements tenus par Eli Wallach ou Rod Steiger chez ce cinéaste), il devra pourtant lui aussi s’effacer, n’ayant plus grand-chose à tourner en dérision. Seule la femme, personnage d’une importance nouvelle chez Leone, elle-même archétype de la putain au cœur d’or et à la flamboyance tragique de Claudia Cardinale, mais pressée de laisser le passé et les vicissitudes derrière elle pour bâtir son propre destin, finira par trouver son compte dans la société des hommes en mutation où la conquête de l’Ouest, réelle ou fantasmée, n’est plus ce qu’elle était.
Difficile d’imaginer plus belle et plus déchirante analogie autour d’un deuil long à porter et d’une passation de pouvoir. Leone s’est assez joué, dans ses films précédents, des propositions narratives devenues codes bien sages du western classique. Avec Il était une fois dans l’Ouest, c’est sans malice qu’il compose et interprète pour le disparu une ultime marche funèbre. Et cette familière emphase de cinéma, celle des gros plans en scope, de la suspension du temps et du montage épousant la musique de Morricone, joue cette partition-là en mettant en avant des caractéristiques qu’on lui connaissait certes auparavant, mais qui s’affirment ici en marquant bien la différence avec l’état d’esprit des films précédents. Les aventures aux accents parodiques de l’« Homme Sans Nom » enchaînaient péripéties et rebondissements, s’autorisaient à être perturbées par des digressions. Ici, au contraire, chaque scène s’étire au maximum, creusant les moments de silence, les pauses dans des dialogues tendus, l’attente du règlement de comptes final ; et les digressions, devenues ici presque une règle, ne s’imposent pas comme élément perturbateur, mais comme facteur de repos et de salut, laissant espérer que par-delà ce qui est pour certains une marche vers la mort, d’autres horizons sont offerts aux personnages – et au cinéma – en quête d’avenir. Ainsi la marche funèbre prend-elle son temps, le temps d’y observer la mort au travail, le temps d’en espérer autant que d’en craindre la fin, tandis que de temps à autre le fatidique air d’harmonica rappelle l’existence d’une menace imminente et grave. L’instrument de Bronson, voué à ne produire qu’une même musique immuable, joue un peu le même rôle, quoique répété ici de façon lancinante, que la montre-boîte à musique d’Et pour quelques dollars de plus. Deux objets-stigmates d’un traumatisme ancien réunissant assassin et vengeur dans la même pulsion de mort, ce sont eux qui décident à quel pas aller vers l’accomplissement fatal de cette pulsion, et même qui doit vivre ou mourir. Une fois cela résolu, devenus inutiles, leur musique s’arrête. Il est alors temps pour Leone d’aller, enfin, jouer ailleurs.
Benoît smith (Critikat)
Ciné classique
dimanche 23 octobre
2016 à 17h45
présenté par Jean Pierre Bleys, spécialiste en histoire du cinéma
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
de Sergio Leone
avec Henry Fonda, Charles Bronson, Frank Wolff
USA - ITALIE - 1968 - 2h55 - VOST - Réédition - Version restaurée
Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain est tué avec ses trois enfants. Jill McBain hérite alors des terres de son mari, terres que convoite Morton, le commanditaire du crime (celles-ci ont de la valeur maintenant que le chemin de fer doit y passer). Mais les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne...
http://www.splendor-films.com/items/item/468
A PROPOS
Ce film qui a avec le temps mis tout le monde d’accord au sujet de Sergio Leone – même ceux qui ne sauraient en citer que des notes d’harmonica –, ce classique qui marche entre les tombes des classiques, son auteur aurait peut-être voulu ne pas devoir le faire. L’Italien pensait bien en avoir fini avec le western, genre qu’il avait enflé, étiré, dépouillé avec sa trilogie de l’« Homme Sans Nom » (ou « du Dollar »). Mais voilà : avant qu’il ne puisse concrétiser ses envies d’ailleurs (interroger d’autres mythologies : il n’aurait, en vérité, que ses trois Il était une fois pour le faire), les studios américains qui, ironiquement, voyaient en lui la relève du classicisme auquel il n’avait cessé de se confronter, insistèrent pour que son Cinémascope furieux fasse de nouveau parler la poudre dans son Far West à la bolognaise. Qu’à cela ne tienne : au lieu de la redite attendue des transgressions facétieuses à l’œuvre dans ses films précédents, Il était une fois dans l’Ouest, moins ricanant et plus sentimental, serait son film idéal pour tourner définitivement la page.
Au bout de treize interminables minutes d’attente où les bruits ambiants forment un orchestre pour combler le silence aussi lourd que le soleil, trois hommes – dont deux têtes familières du western classique, Woody Strode et Jack Elam – se font dessouder sur un quai de gare par un Charles Bronson maniaque de l’harmonica, lui-même passé des sept gentils Mercenaires aux Douze Salopards. Le film vient à peine de commencer. Nouvel acte de défi, voire de guerre, envers le vénérable genre ? Pas vraiment, comprend-on rapidement : Leone, pourtant volontiers sacrilège, n’est pas du genre à s’acharner sur un cadavre. Le décès de l’ancêtre est déjà notifié, ne fût-ce que par le défilé d’allusions plus ou moins directes à d’illustres représentants comme La Prisonnière du désert, Le train sifflera trois fois ou 3h10 pour Yuma. Coécrit avec Leone par deux critiques de cinéma et futurs réalisateurs cinéphiles, Argento et Bertolucci, Il était une fois dans l’Ouest aura contribué à introduire à Hollywood l’idée, apparue avec la Nouvelle Vague française, de films qui évoqueraient d’autres films, qui leur rendraient hommage, qui surtout prendraient acte de leur statut d’œuvres du passé tout en attestant leur héritage.
Ainsi le western d’antan, qui commençait à s’éteindre au moment où Ford réalisait L’Homme qui tua Liberty Valance en 1962, se trouve bien six pieds sous terre quand Leone s’intéresse de nouveau à lui en 1968 – le meilleur indice n’en reste-t-il pas les appels répétés de Hollywood à l’Italien pour prendre la relève dans l’espoir de réincarner le défunt ? Les traces qui en subsistent pourrissent et exhibent leur corruption à ciel ouvert (à l’image d’un Henry Fonda aux yeux bleus duquel on donnait jadis le Bon Dieu sans confession, devenu ici une ordure indéfendable que la caméra révèle de façon théâtrale et implacable), vestiges que l’obsessionnelle quête de vengeance de Bronson, l’« Harmonica » hanté par son héritage, n’a pour but, au fond, que de balayer avant de passer enfin à autre chose. Seulement, ce vengeur solitaire n’en est pas moins lui-même un autre vestige usé des mythes et archétypes passés, et dès lors se trouve lui aussi appelé à disparaître une fois son œuvre achevée et sa pulsion de mort satisfaite. Tout comme le hors-la-loi joué par Jason Robards, impliqué malgré lui dans le contentieux entre Bronson et Fonda : sans doute le personnage le plus « leonien » du lot (proche des rôles de bandit sale, vulgaire et un peu malmené par les événements tenus par Eli Wallach ou Rod Steiger chez ce cinéaste), il devra pourtant lui aussi s’effacer, n’ayant plus grand-chose à tourner en dérision. Seule la femme, personnage d’une importance nouvelle chez Leone, elle-même archétype de la putain au cœur d’or et à la flamboyance tragique de Claudia Cardinale, mais pressée de laisser le passé et les vicissitudes derrière elle pour bâtir son propre destin, finira par trouver son compte dans la société des hommes en mutation où la conquête de l’Ouest, réelle ou fantasmée, n’est plus ce qu’elle était.
Difficile d’imaginer plus belle et plus déchirante analogie autour d’un deuil long à porter et d’une passation de pouvoir. Leone s’est assez joué, dans ses films précédents, des propositions narratives devenues codes bien sages du western classique. Avec Il était une fois dans l’Ouest, c’est sans malice qu’il compose et interprète pour le disparu une ultime marche funèbre. Et cette familière emphase de cinéma, celle des gros plans en scope, de la suspension du temps et du montage épousant la musique de Morricone, joue cette partition-là en mettant en avant des caractéristiques qu’on lui connaissait certes auparavant, mais qui s’affirment ici en marquant bien la différence avec l’état d’esprit des films précédents. Les aventures aux accents parodiques de l’« Homme Sans Nom » enchaînaient péripéties et rebondissements, s’autorisaient à être perturbées par des digressions. Ici, au contraire, chaque scène s’étire au maximum, creusant les moments de silence, les pauses dans des dialogues tendus, l’attente du règlement de comptes final ; et les digressions, devenues ici presque une règle, ne s’imposent pas comme élément perturbateur, mais comme facteur de repos et de salut, laissant espérer que par-delà ce qui est pour certains une marche vers la mort, d’autres horizons sont offerts aux personnages – et au cinéma – en quête d’avenir. Ainsi la marche funèbre prend-elle son temps, le temps d’y observer la mort au travail, le temps d’en espérer autant que d’en craindre la fin, tandis que de temps à autre le fatidique air d’harmonica rappelle l’existence d’une menace imminente et grave. L’instrument de Bronson, voué à ne produire qu’une même musique immuable, joue un peu le même rôle, quoique répété ici de façon lancinante, que la montre-boîte à musique d’Et pour quelques dollars de plus. Deux objets-stigmates d’un traumatisme ancien réunissant assassin et vengeur dans la même pulsion de mort, ce sont eux qui décident à quel pas aller vers l’accomplissement fatal de cette pulsion, et même qui doit vivre ou mourir. Une fois cela résolu, devenus inutiles, leur musique s’arrête. Il est alors temps pour Leone d’aller, enfin, jouer ailleurs.
Benoît smith (Critikat)