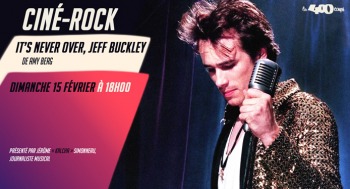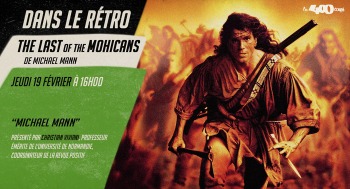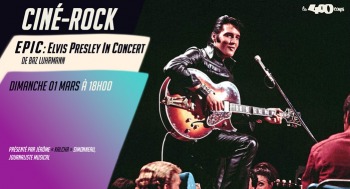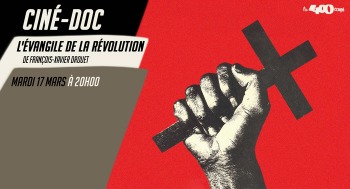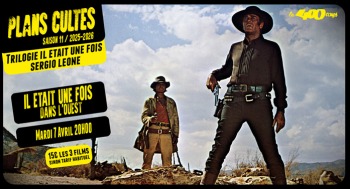ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS
C’est très beau, la naissance d’une intransigeance. Augustine, premier long-métrage de la réalisatrice Alice Winocour, n’est pas seulement un film mais un acte cinématographique. Sélectionné à la Semaine de la Critique, le film émeut autant par son récit que par la rareté du geste qu’il nous donne à voir : la méthodique construction d’une révolte artistique. Et parce que Winocour est une vraie cinéaste, son coup de poing est un regard.
« Et j’ai crié qu’il fallait libérer les femmes. » C’est bien une patiente actuelle souffrant de crises d’hystérie qui prononce ces mots, les yeux pointés vers les nôtres, au beau milieu d’une fiction en costume. Bergman avait déjà osé percer le contrat de fiction de témoignages documentaires en regards-caméra, mais c’était en 1969, et Une passion était loin d’être son premier film. À croire qu’en égrenant ces aveux droit dans l’optique, Winocour veut commencer là où certains grands se sont arrêtés, à l’idée que la fiction, ce n’est pas moins ou plus que le réel, mais une manière de le regarder dans les yeux. Caméra-regard.
C’est évident, regarder, Winocour ne sait faire que ça, tant son film apparaît comme un observatoire d’une heure trois-quart des conditions d’exercice de la domination masculine. Pour elle, le mérite est immense, car rien n’est moins naturel au cinéma que le regard : c’est une construction, une décision de cinéaste. Au fond, Augustine regarde le dix-neuvième siècle, temps fort du positivisme scientifique, à l’aune de ce que le début du siècle suivant redécouvrira : qu’une observation passive et distanciée pourrait scientifiquement laisser tranquille son objet n’est qu’une chimère de cabinet. Le Charcot du film (Vincent Lindon, absolument parfait) se fait fort d’incarner cette distance qui pense pouvoir comprendre sans toucher. Mais, derrière son vernis social, il sent bien qu’observer, c’est toujours provoquer. Un vrai regard de cinéma, c’est exactement la même chose : une méthode qui dérange son objet. Voilà qui est dit.
Voilà qui est fait, répond Winocour. Les premières secondes du film, en un champ-contrechamp, a le cran d’imposer la réunion, sous un seul et même coup d’œil, de deux réalités fort différentes : le dernier bâillement d’une araignée de mer dans une casserole d’eau bouillante et l’angoisse contenue d’Augustine, bonne à tout faire dans une maison bourgeoise, se sentant sur le point d’entrer en une de ses maladives irruptions. Tristesse infinie de cette métaphore introductive : la jeune femme, à peine naissante en elle, dépeinte en crustacé mourant. Ce mariage des images vaut autant par son sens que par son opposition à ce qui la fonde. Car cette pression, elle est bourgeoise et masculine, deux traits que le film ne séparera pas une seconde. Il faut lire la scène que lancent ces premiers plans, où la petite servante, prise d’une crise d’hystérie, s’effondre au milieu d’un dîner mondain, comme l’art poétique de mademoiselle Winocour : tirer la nappe à elle et foutre la table en l’air, voilà le programme du film. Féministe évidemment, si par féminisme on entend un projet global de révolte.
Féministe, plus précisément, dans le regard qu’elle impose et dans celui, masculino-centré, qu’elle subvertit habilement. Augustine, dont le médecin Charcot décide de provoquer publiquement les crises sous hypnose, va ainsi offrir malgré elle, à une assemblée d’hommes qui lui fait radicalement face, son inconscient en spectacle. Ce huis clos aux airs de dispositif formel permet à Winocour de reproduire, dans le calme d’un laboratoire, une fascinante mise en scène du regard contraignant. Seuls leurs cigares rappellent qu’ils n’ont rien d’ingénus écoliers abasourdis de découvrir ce qu’advient le désir loin des brides masculines : frottement, cris, râles, jouissances ; en un mot, violence. Ce que nous voyons alors, ce que Winocour veut que nous regardons, c’est évidemment moins cette femme transformée en support de visions que l’œil masculin collectif qui la dévore.
Si Charcot, pourtant pétri des mêmes codes sexistes que cette meute de notables, ne lui est pas totalement assimilable, c’est qu’au contact d’Augustine, il n’est plus qu’un regard désirant qui n’ose pas, un regard qui se sait destiné à rester en lui-même, quand ceux des autres ferment et inondent la scène. Le lieu définitif de Winocour dans ce film est donc un endroit bien connu des amoureux : elle en est restée à ce qu’un geste n’a pas le droit, pour des raisons sociales, d’aller au-delà d’un certain seuil. Il était presque logique que Winocour retrouve ici la forme que les poètes ont donné à cette impossibilité : le topos de l’échange des regards, toujours plus fluctuant et permissif qu’une déontologie médicale. Dans ses mises en spectacle, elle télescope l’œil géant d’une multitude de visiteurs libidineux et l’attirance impossible de Charcot pour Augustine et d’Augustine pour Charcot sous la forme de regards qui passent leur temps à s’avouer qu’ils crèvent de ne pas être caresses. Sans l’échange de regards, son film aurait pu s’appeler A Dangerous Method et plonger dans la seule exhibition corporelle. Mais même dans les scènes où la chair est mise à nu, elle s’est arrêtée bien avant Cronenberg, bien avant la crudité. Et pas plus qu’elle ne touille la peau pour donner forme aux tréfonds de l’âme humaine, elle ne cherche à faire de la découpe corporelle. Il n’y a pas l’ombre d’un Géricault anatomiste dans son approche filmique du corps.
Pour bien comprendre sa « manière », il faut regarder le travail de Charcot sur le corps d’Augustine. Au crayon de sa science, il trace des lignes sur sa poitrine, passe près de ses aisselles, fait le tour de ses seins. Que ces repères pour une caresse disparaissent dans la brutalité d’un ébat final, n’annule pas ce qui se passe à chaque fois que les corps de Lindon et Soko se rapprochent : encore une fois, ils se regardent. L’image de Winocour, comme ce crayon et nos yeux de spectateurs, affleure ainsi l’épiderme, le suit, s’y pose et y trace des inflexions mais ne le tranche pas. Cette caresse des yeux détaille ou enveloppe (cette alternance est d’ailleurs ce qu’il y a de plus génial dans ce film), mais jamais n’incise pour nous faire voir l’intérieur. Que Charcot en vienne, sous prétexte de la « guérir », à exiger que son assistant visse un peu plus la machine qui la torture, ne change rien à l’affaire. Winocour est jeune cinéaste mais pas niaise. Elle sait bien qu’en matière de désir, la douceur n’est pas douce.
Matthieu Bareyre (Critikat)
Soirée CinéConf
jeudi 16 février
2023 à 20h00
En présence d'Aurélie Cachera (Maîtresse de conférences en littérature et histoire des idées du monde germanophone, Université d’Angers) et Yvelin Ducotey (Docteur en études anglophones, spécialisé en études filmiques, Université d’Angers, et coordinateur du cycle CinéConf)
AUGUSTINE
de Alice Winocour
avec Vincent Lindon, Soko, Chiara Mastroianni
FRANCE - 2012 - 1h41
Paris, hiver 1885. À l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, le professeur Charcot étudie une maladie mystérieuse : l'hystérie. Augustine, 19 ans, devient son cobaye favori, la vedette de ses démonstrations d'hypnose. D'objet d'étude, elle deviendra peu à peu objet de désir.
http://www.arpselection.com/category/tous-nos-films/drame/augustine-133.html#team
A PROPOS
C’est très beau, la naissance d’une intransigeance. Augustine, premier long-métrage de la réalisatrice Alice Winocour, n’est pas seulement un film mais un acte cinématographique. Sélectionné à la Semaine de la Critique, le film émeut autant par son récit que par la rareté du geste qu’il nous donne à voir : la méthodique construction d’une révolte artistique. Et parce que Winocour est une vraie cinéaste, son coup de poing est un regard.
« Et j’ai crié qu’il fallait libérer les femmes. » C’est bien une patiente actuelle souffrant de crises d’hystérie qui prononce ces mots, les yeux pointés vers les nôtres, au beau milieu d’une fiction en costume. Bergman avait déjà osé percer le contrat de fiction de témoignages documentaires en regards-caméra, mais c’était en 1969, et Une passion était loin d’être son premier film. À croire qu’en égrenant ces aveux droit dans l’optique, Winocour veut commencer là où certains grands se sont arrêtés, à l’idée que la fiction, ce n’est pas moins ou plus que le réel, mais une manière de le regarder dans les yeux. Caméra-regard.
C’est évident, regarder, Winocour ne sait faire que ça, tant son film apparaît comme un observatoire d’une heure trois-quart des conditions d’exercice de la domination masculine. Pour elle, le mérite est immense, car rien n’est moins naturel au cinéma que le regard : c’est une construction, une décision de cinéaste. Au fond, Augustine regarde le dix-neuvième siècle, temps fort du positivisme scientifique, à l’aune de ce que le début du siècle suivant redécouvrira : qu’une observation passive et distanciée pourrait scientifiquement laisser tranquille son objet n’est qu’une chimère de cabinet. Le Charcot du film (Vincent Lindon, absolument parfait) se fait fort d’incarner cette distance qui pense pouvoir comprendre sans toucher. Mais, derrière son vernis social, il sent bien qu’observer, c’est toujours provoquer. Un vrai regard de cinéma, c’est exactement la même chose : une méthode qui dérange son objet. Voilà qui est dit.
Voilà qui est fait, répond Winocour. Les premières secondes du film, en un champ-contrechamp, a le cran d’imposer la réunion, sous un seul et même coup d’œil, de deux réalités fort différentes : le dernier bâillement d’une araignée de mer dans une casserole d’eau bouillante et l’angoisse contenue d’Augustine, bonne à tout faire dans une maison bourgeoise, se sentant sur le point d’entrer en une de ses maladives irruptions. Tristesse infinie de cette métaphore introductive : la jeune femme, à peine naissante en elle, dépeinte en crustacé mourant. Ce mariage des images vaut autant par son sens que par son opposition à ce qui la fonde. Car cette pression, elle est bourgeoise et masculine, deux traits que le film ne séparera pas une seconde. Il faut lire la scène que lancent ces premiers plans, où la petite servante, prise d’une crise d’hystérie, s’effondre au milieu d’un dîner mondain, comme l’art poétique de mademoiselle Winocour : tirer la nappe à elle et foutre la table en l’air, voilà le programme du film. Féministe évidemment, si par féminisme on entend un projet global de révolte.
Féministe, plus précisément, dans le regard qu’elle impose et dans celui, masculino-centré, qu’elle subvertit habilement. Augustine, dont le médecin Charcot décide de provoquer publiquement les crises sous hypnose, va ainsi offrir malgré elle, à une assemblée d’hommes qui lui fait radicalement face, son inconscient en spectacle. Ce huis clos aux airs de dispositif formel permet à Winocour de reproduire, dans le calme d’un laboratoire, une fascinante mise en scène du regard contraignant. Seuls leurs cigares rappellent qu’ils n’ont rien d’ingénus écoliers abasourdis de découvrir ce qu’advient le désir loin des brides masculines : frottement, cris, râles, jouissances ; en un mot, violence. Ce que nous voyons alors, ce que Winocour veut que nous regardons, c’est évidemment moins cette femme transformée en support de visions que l’œil masculin collectif qui la dévore.
Si Charcot, pourtant pétri des mêmes codes sexistes que cette meute de notables, ne lui est pas totalement assimilable, c’est qu’au contact d’Augustine, il n’est plus qu’un regard désirant qui n’ose pas, un regard qui se sait destiné à rester en lui-même, quand ceux des autres ferment et inondent la scène. Le lieu définitif de Winocour dans ce film est donc un endroit bien connu des amoureux : elle en est restée à ce qu’un geste n’a pas le droit, pour des raisons sociales, d’aller au-delà d’un certain seuil. Il était presque logique que Winocour retrouve ici la forme que les poètes ont donné à cette impossibilité : le topos de l’échange des regards, toujours plus fluctuant et permissif qu’une déontologie médicale. Dans ses mises en spectacle, elle télescope l’œil géant d’une multitude de visiteurs libidineux et l’attirance impossible de Charcot pour Augustine et d’Augustine pour Charcot sous la forme de regards qui passent leur temps à s’avouer qu’ils crèvent de ne pas être caresses. Sans l’échange de regards, son film aurait pu s’appeler A Dangerous Method et plonger dans la seule exhibition corporelle. Mais même dans les scènes où la chair est mise à nu, elle s’est arrêtée bien avant Cronenberg, bien avant la crudité. Et pas plus qu’elle ne touille la peau pour donner forme aux tréfonds de l’âme humaine, elle ne cherche à faire de la découpe corporelle. Il n’y a pas l’ombre d’un Géricault anatomiste dans son approche filmique du corps.
Pour bien comprendre sa « manière », il faut regarder le travail de Charcot sur le corps d’Augustine. Au crayon de sa science, il trace des lignes sur sa poitrine, passe près de ses aisselles, fait le tour de ses seins. Que ces repères pour une caresse disparaissent dans la brutalité d’un ébat final, n’annule pas ce qui se passe à chaque fois que les corps de Lindon et Soko se rapprochent : encore une fois, ils se regardent. L’image de Winocour, comme ce crayon et nos yeux de spectateurs, affleure ainsi l’épiderme, le suit, s’y pose et y trace des inflexions mais ne le tranche pas. Cette caresse des yeux détaille ou enveloppe (cette alternance est d’ailleurs ce qu’il y a de plus génial dans ce film), mais jamais n’incise pour nous faire voir l’intérieur. Que Charcot en vienne, sous prétexte de la « guérir », à exiger que son assistant visse un peu plus la machine qui la torture, ne change rien à l’affaire. Winocour est jeune cinéaste mais pas niaise. Elle sait bien qu’en matière de désir, la douceur n’est pas douce.
Matthieu Bareyre (Critikat)