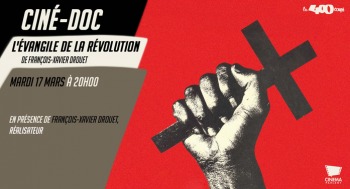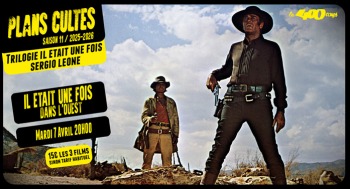ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS
Au cœur du dernier long-métrage de Pedro Costa trône, comme l’indique le titre, une femme : Vitalina Varela. Déjà présente dans Cavalo Dinheiro, elle donne à cette nouvelle fiction mêlée de documentaire sa force obscure. C’est justement sous la forme d’une silhouette noire se détachant sur l’entrée lumineuse d’un avion qu’apparaît pour la première fois la capverdienne d’une cinquantaine d’années. Tandis qu’elle descend de l’engin, la veuve aux pieds nus répand sur son passage comme une traînée de tristesse, chaque pas s’accompagnant de larmes maculant le sol. Sa douleur semble n’avoir d’égal que le vacarme insupportable produit par l’appareil, entre vrombissements et sonneries intempestives. En bas des marches, une cohorte de femmes de ménage forme un comité d’accueil aux nouvelles funestes : Vitalina arrive trop tard à Lisbonne, trois jours après la mort de son mari, et n’est visiblement pas la bienvenue dans le pays. La façon dont Pedro Costa ne révèle que très progressivement le visage de son héroïne (d’abord plongée dans le noir, filmée de dos ou morcelée par le cadre) fait écho au long silence dont émerge celle qui a attendu, vingt-cinq ans durant, son billet d’avion pour le Portugal.
Costa filme souvent Vitalina devant l’embrasure d’une porte, c’est-à-dire sur le fil d’une démarcation entre deux espaces : une position qui fait sens pour ce personnage partagé entre deux pays mais aussi entre deux mondes, celui des vivants et celui des morts. Cette mise en abîme nourrit une atmosphère étouffante en rétrécissant l’espace autour d’individus déjà dévorés par le noir. Elle sert aussi d’écrin à un portait complexe, fait d’une somme de contradictions : si Vitalina semble être d’abord accablée par la fatigue – son corps peine à se mouvoir et s’essouffle rapidement –, il est pourtant difficile de ne pas entendre dans son prénom une promesse de vitalité. Cette force qui l’a poussé jadis à bâtir une maison de ses propres mains est aujourd’hui celle qui l’amène à rester chez son mari, envers et contre tous. Sa voix, sorte de murmure enragé, figure bien ce mélange de chagrin et de rancœur, de douceur et de dureté, qui la caractérise. Un long plan met en évidence une photo de mariage où elle apparaît seule, pointant l’abandon dont elle fait toujours grief à son époux : contrairement à ses promesses, celui-ci ne l’a en effet jamais rejoint au Cap-Vert et ils auront vécu séparés presque toute leur vie. Ni la misère ni la peine ne réussissent cependant à entamer son élégance et sa grâce serpentine, particulièrement visible dans un plan où ses yeux luisants et son corps tordu dans une posture étrange lui donnent des allures de reptile.
Les ténèbres qui entourent Vitalina sont celles de son amour perdu, une « clarté » disparue, comme la croyance qui a déserté ce monde désormais sans toit – le sien menace de s’effondrer sur sa tête – ni foi. « J’ai perdu ma foi dans l’obscurité » confesse le prêtre incarné par Ventura, figure familière de l’œuvre de Pedro Costa, que l’on retrouve ici dans un second rôle. L’autel du défunt ne sert qu’à allumer la cigarette d’une visiteuse, tandis que l’église faite de tôle et de terre battue tient à peine debout, à l’image de l’ecclésiastique qui n’a de cesse de s’écrouler. Dans un plan où le soleil apparaît (symboliquement) à travers les barreaux d’une fenêtre, Ventura est d’ailleurs placé au centre d’un cercle d’où s’échappent quelques rayons, devenant ainsi le héraut d’une divinité déchue. Si l’espérance a quitté les résidents du quartier de Cova da Moura, c’est aussi qu’il n’y a plus de ciel vers lequel prier : les murs, aussi élevés que ceux d’une prison, ombragent les rues et les masures.
Les habitants, qui ne sont littéralement plus que l’ombre d’eux-mêmes, errent le long de ces étroits corridors comme dans un labyrinthe sans issue. Lorsqu’il qu’il déambule dans les rues comme un vieux fou, Ventura semble tourner en rond, posant sa main tremblante sur le même poteau. Les seules ouvertures possibles n’en sont pas : lors de son arrivée, la protagoniste se cogne contre une paroi invisible (son visage jusqu’alors obscurci est ainsi dévoilé pour la première fois) et on remarque, sur l’un des murs de sa chambre, une fenêtre bouchée par un mur de briques. Les escaliers, saisis dans des contreplongées écrasantes, ne débouchent sur rien et composent des architectures aussi absurdes que précaires. Les tunnels parcourus de tuyaux et de bruits liquides donnent quant à eux le sentiment d’être plongé dans les entrailles d’un corps malade. Ce lieu utérin, aux sons étouffés, n’a pourtant rien de rassurant ni d’intime : à travers des portes sans serrure, des importuns s’invitent sans cesse chez Vitalina Varela. Les limites entre le dedans et le dehors sont définitivement brouillées puisque même à l’extérieur, la nuit forme comme une seconde cage autour des personnages. Bien que plongé dans la pénombre, le film s’achève néanmoins sur les réminiscences d’une existence heureuse, aussi claire que le jour. Au terme de son éprouvante plongée dans les ténèbres, Vitalina retrouve un peu de la lumière d’antan, suffisamment du moins pour déclarer, en dépit d’avoir été dépossédée de sa propre vie : « l’amour est si important ». Par cet oppressant théâtre d’ombres où errent quelques fantômes désespérés, Pedro Costa aura figuré l’injustice d’un monde dans lequel une partie de l’humanité semble condamnée à l’oubli.
Chloé Cavillier (Critikat)
Angers fête l'Europe
vendredi 27 mai
2022 à 18h00
Séance organisée dans le cadre de Angers Fête l'Europe (manifestation annuelle coordonnée par la Ville d’Angers afin de valoriser la construction de l’Union européenne et de sensibiliser les Angevins aux cultures européennes) et de la Saison France Portugal 2022
Séance organisée en partenariat avec le Festival Premiers Plans
VITALINA VARELA
de Pedro Costa
avec Vitalina Varela, Ventura, Manuel Tavares Almeida
Portugal - 2019 - 2h04 - Version originale sous titrée
Vitalina Varela, une Cap-Verdienne de 55 ans, arrive à Lisbonne trois jours après les obsèques de son mari. Elle a attendu son billet d'avion pendant plus de 25 ans.
https://www.survivance.net/document/72/69/VITALINA-VARELA
A PROPOS
Au cœur du dernier long-métrage de Pedro Costa trône, comme l’indique le titre, une femme : Vitalina Varela. Déjà présente dans Cavalo Dinheiro, elle donne à cette nouvelle fiction mêlée de documentaire sa force obscure. C’est justement sous la forme d’une silhouette noire se détachant sur l’entrée lumineuse d’un avion qu’apparaît pour la première fois la capverdienne d’une cinquantaine d’années. Tandis qu’elle descend de l’engin, la veuve aux pieds nus répand sur son passage comme une traînée de tristesse, chaque pas s’accompagnant de larmes maculant le sol. Sa douleur semble n’avoir d’égal que le vacarme insupportable produit par l’appareil, entre vrombissements et sonneries intempestives. En bas des marches, une cohorte de femmes de ménage forme un comité d’accueil aux nouvelles funestes : Vitalina arrive trop tard à Lisbonne, trois jours après la mort de son mari, et n’est visiblement pas la bienvenue dans le pays. La façon dont Pedro Costa ne révèle que très progressivement le visage de son héroïne (d’abord plongée dans le noir, filmée de dos ou morcelée par le cadre) fait écho au long silence dont émerge celle qui a attendu, vingt-cinq ans durant, son billet d’avion pour le Portugal.
Costa filme souvent Vitalina devant l’embrasure d’une porte, c’est-à-dire sur le fil d’une démarcation entre deux espaces : une position qui fait sens pour ce personnage partagé entre deux pays mais aussi entre deux mondes, celui des vivants et celui des morts. Cette mise en abîme nourrit une atmosphère étouffante en rétrécissant l’espace autour d’individus déjà dévorés par le noir. Elle sert aussi d’écrin à un portait complexe, fait d’une somme de contradictions : si Vitalina semble être d’abord accablée par la fatigue – son corps peine à se mouvoir et s’essouffle rapidement –, il est pourtant difficile de ne pas entendre dans son prénom une promesse de vitalité. Cette force qui l’a poussé jadis à bâtir une maison de ses propres mains est aujourd’hui celle qui l’amène à rester chez son mari, envers et contre tous. Sa voix, sorte de murmure enragé, figure bien ce mélange de chagrin et de rancœur, de douceur et de dureté, qui la caractérise. Un long plan met en évidence une photo de mariage où elle apparaît seule, pointant l’abandon dont elle fait toujours grief à son époux : contrairement à ses promesses, celui-ci ne l’a en effet jamais rejoint au Cap-Vert et ils auront vécu séparés presque toute leur vie. Ni la misère ni la peine ne réussissent cependant à entamer son élégance et sa grâce serpentine, particulièrement visible dans un plan où ses yeux luisants et son corps tordu dans une posture étrange lui donnent des allures de reptile.
Les ténèbres qui entourent Vitalina sont celles de son amour perdu, une « clarté » disparue, comme la croyance qui a déserté ce monde désormais sans toit – le sien menace de s’effondrer sur sa tête – ni foi. « J’ai perdu ma foi dans l’obscurité » confesse le prêtre incarné par Ventura, figure familière de l’œuvre de Pedro Costa, que l’on retrouve ici dans un second rôle. L’autel du défunt ne sert qu’à allumer la cigarette d’une visiteuse, tandis que l’église faite de tôle et de terre battue tient à peine debout, à l’image de l’ecclésiastique qui n’a de cesse de s’écrouler. Dans un plan où le soleil apparaît (symboliquement) à travers les barreaux d’une fenêtre, Ventura est d’ailleurs placé au centre d’un cercle d’où s’échappent quelques rayons, devenant ainsi le héraut d’une divinité déchue. Si l’espérance a quitté les résidents du quartier de Cova da Moura, c’est aussi qu’il n’y a plus de ciel vers lequel prier : les murs, aussi élevés que ceux d’une prison, ombragent les rues et les masures.
Les habitants, qui ne sont littéralement plus que l’ombre d’eux-mêmes, errent le long de ces étroits corridors comme dans un labyrinthe sans issue. Lorsqu’il qu’il déambule dans les rues comme un vieux fou, Ventura semble tourner en rond, posant sa main tremblante sur le même poteau. Les seules ouvertures possibles n’en sont pas : lors de son arrivée, la protagoniste se cogne contre une paroi invisible (son visage jusqu’alors obscurci est ainsi dévoilé pour la première fois) et on remarque, sur l’un des murs de sa chambre, une fenêtre bouchée par un mur de briques. Les escaliers, saisis dans des contreplongées écrasantes, ne débouchent sur rien et composent des architectures aussi absurdes que précaires. Les tunnels parcourus de tuyaux et de bruits liquides donnent quant à eux le sentiment d’être plongé dans les entrailles d’un corps malade. Ce lieu utérin, aux sons étouffés, n’a pourtant rien de rassurant ni d’intime : à travers des portes sans serrure, des importuns s’invitent sans cesse chez Vitalina Varela. Les limites entre le dedans et le dehors sont définitivement brouillées puisque même à l’extérieur, la nuit forme comme une seconde cage autour des personnages. Bien que plongé dans la pénombre, le film s’achève néanmoins sur les réminiscences d’une existence heureuse, aussi claire que le jour. Au terme de son éprouvante plongée dans les ténèbres, Vitalina retrouve un peu de la lumière d’antan, suffisamment du moins pour déclarer, en dépit d’avoir été dépossédée de sa propre vie : « l’amour est si important ». Par cet oppressant théâtre d’ombres où errent quelques fantômes désespérés, Pedro Costa aura figuré l’injustice d’un monde dans lequel une partie de l’humanité semble condamnée à l’oubli.
Chloé Cavillier (Critikat)