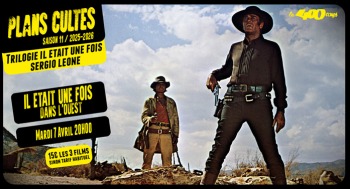ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS
Voici 25 ans déjà qu’est sorti en salles « Boyz’n’The Hood ». Son South Central sous tension, son Laurence Fishburne post-Abel Ferrara, sa B.O où Ice Cube côtoie Monie Love et Quincy Jones. Le cinéaste John Singleton est récemment revenu sur l’accueil de son film le plus estimé et l’influence de celui-ci sur le paysage culturel, au gré des décennies.
C’était la grande époque de la « hoodploitation », ou « cinéma de ghettos », un courant cinématographique où s’entrechoquaient l’iconographie gangsta, la culture reality rap et les aspérités de la chronique sociale. La hoodploitation est l’héritière du mouvement seventies de la blaxploitation, qui mettait en évidence le « black power » au gré d’icônes funky de séries B, films d’exploitation et autres figures sulfureuses (Shaft, Dolemite, le réalisateur Melvin Van Peebles, l’actrice Pam Grier) tout en décalquant le naturalisme (Mean Streets) et l’épate (Les Affranchis) de Scorsese, voire la subversion du Scarface de De Palma.
Boyz n The Hood se situe au coeur de cette vague nineties, aux côtés du Menace II Society des frères Hugues, de New Jack City et des premières oeuvres de Spike Lee. Son succès – 57 millions de dollars de recettes – en fera une oeuvre emblématique, nommée par deux fois aux Oscars, présentée à Un Certain Regard à l’édition 91 du Festival de Cannes et reconnue par la Library of Congress comme commentaire social d’utilité publique.
Boyz n The Hood, tout en mettant en scène l’oppression de la classe afro-américaine fut le vecteur de talents et de figures évocatrices. De jeunes interprètes révélés ou magnifiés, parmi lesquels figurent Cuba Gooding Jr., Ice Cube, Nia Long, ou encore Regina King. Une jeunesse qui ferait de ce mouvement une sorte de Nouvelle Vague black. Cette oeuvre est ainsi le premier long-métrage d’un auteur débutant, pourvu de ses propres mentors et qui souhaitait, en 1991, privilégier une certaine conscience sociopolitique tout en affirmant sa naissante identité d’artiste.
« J’ai l’impression de pénétrer au sein d’une machine à voyager dans le temps dès que je fais référence à toute cette époque. J’ai écrit le scénario de Boyz n the Hood quand j’avais seulement vingt ans. J’avais vu Do The Right Thing de Spike Lee au cours de l’été 89. Je suis directement tombé amoureux de Spike, il est devenu, en quelque sorte, mon grand-frère de cinéma. Je l’ai rencontré deux avants de débuter mon film de fin d’année pour l’Université de Californie du Sud. A l’école la marginalisation de la classe afroaméricaine était continuelle. On disait de moi : « Oh, il va juste devenir un autre Spike Lee » et tout ce genre de choses. Mais j’étais genre « non, je ne serai pas le prochain Spike Lee, je serai le prochain John Singleton« . Je suis donc parti de la fac en me disant que je deviendrai l’équivalent de la NBA ou le NFL pour le cinéma. Tout ce que je savais, je l’avais vu dans le ghetto. Alors je suis parti avec mes potes sur Vermont Avenue en décidant de raconter notre histoire. Tout le projet vient de là : j’essayais de bâtir ma propre identité en tant que cinéaste vivant à Los Angeles, et je concevais en une certaine partie de Los Angeles une partie de mon identité »
Boyz n The Hood, le Michael Jordan du film de banlieues ? Il aura en tout cas la notoriété populaire propre au sport d’équipe, sachant toucher les publics, peu importe l’origine sociale du spectateur. Ce cinéma à la fois communautaire et populaire définit la nécessité d’attribuer à une culture spécifique ses moyens d’expression les plus retentissants, une liberté qui, comme à travers les clips de hip-hop diffusés sur MTV, se voit permise par la médiatisation. « Quand vous êtes au plus près des gens, vous obtenez vos histoires. Tout le monde a une histoire à raconter mais peu ont la possibilité de le faire. Je pensais pouvoir être le porte-parole de ces personnes […] Je me sens comme Ernest Hemingway, qui a voyagé à travers divers endroits tout en écrivant sur ses expériences. J’aime avoir la possibilité de faire ça, j’aime écouter les gens » raconte le cinéaste.
En phase avec le mood musical d’une décennie (les sonorités urbano-fiévreuses du Wu-Tang Clan, du N.W.A, de Jay-Z et de Public Enemy) la hoodploitation s’inscrivait dans la droite lignée idéologique de Spike Lee et de son éloquent Do The Right Thing. Pour Singleton, le black cinema actuel est désormais à bout de souffle et la véhémence qui lui était propre semble être morte avec le regretté Biggie Smalls.
« A l’heure actuelle, le cinéma afro-américain se trouve dans une situation morne et triste. Peu importe combien de thune ces films ont rapporté ou le nombre de hits relatifs à la black culture : ces oeuvres ne possèdent pas la moindre conscience culturelle. Les films n’ont pas tous à faire un état des lieux, être engagés, c’est vrai – mes films n’ont pas vocation de prêche, ce sont avant tout des divertissements. Mais quand le cinéma a un certain poids culturel, alors il divertit. Je ne veux dénigrer personne. Mais j’essaie toujours de m’accorder à ce que Spike Lee privilégiait quand il n’en était seulement qu’à ses débuts derrière la caméra. Il semblait alors nous dire à tous : « Ecoutez, nous pouvons imposer notre propre langage à travers les films de la black culture. Il peut se créer une esthétique de cinéma afro-américain, quelque chose d’unique : le black american cinema«
Plus que le Spike Lee des années 80, véritable porte-parole dont les galvanisants Nola Darling n’en fait qu’à sa tête, School Daze et Jungle Fever furent tout aussi influents concernant le cinéma de Singleton, il faut pour envisager à sa juste valeur l’identité de ce gangsta movie en revenir selon le cinéaste aux classiques de la culture italienne et italo-américaine, soit une certaine histoire de la cinéphilie et une visualisation de l’objectif comme miroir porté sur le réel.
« Si les gens ne se font pas entendre, alors c’est comme s’ils n’existaient pas. Quand j’étais en école de cinéma, j’ai découvert Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica et Rome, ville Ouverte de Roberto Rossellini, deux films italiens post-Seconde Guerre Mondiale, et j’ai pu constater par la suite combien des cinéastes comme Scorsese et Coppola étaient influencés par ces films, des cinéastes qui n’hésitaient pas à mettre en scène les spécificités de la culture italienne. C’est précisément ce que je voulais faire avec le black american cinema. Si vous êtes blanc, il y a certaines blagues que vous ne comprendrez pas en visionnant le film, mais de manière plus universelle, en tant qu’être humain, vous comprendrez forcément ces personnages. C’est sur cela que je suis parti avec Boyz N the Hood. Et c’est très compliqué de développer ça au sein d’un système qui marginalise les artistes de couleur.
La violence du film est-elle celle d’une oraison funèbre ? C’est tout du moins l’esprit d’une légende de la black culture – un « Rap God » – qui plane sur ce film où la Foi en Dieu fait justement office de thématique majeure. Le martyr en question a pour nom 2Pac, celui-là même qui affirmait que, malgré la chaleur de l’asphalte et les fusillades, Life Goes On. En se remémorant l’artiste assassiné, Singleton traite d’un talentueux jeune homme qui, comme lui, avait à peine 22 ans en ce temps-là, une période d’émotions intenses partagée entre dénonciation salvatrice et lucidité nihiliste.
« Tupac n’était pas du tout conscient du don qu’il avait. Personne ne pouvait savoir qu’il allait évoluer et devenir un vrai leader, mais il possédait clairement un potentiel. Je crois que c’est pour cela qu’il n’est plus avec nous en ce moment. C’était un gamin de 21 ans qui dénonçait à la télévision tout ce qui foirait dans ce pays, socialement et multi-ethniquement. Il luttait fortement pour les gens de couleur et le respect des droits de l’homme. Il était emblématique de notre génération, celle qui scandait : « nous ne voulons pas d’un Messie Black, nous voulons juste nous en sortir«
Malgré tout, ne nous y trompons pas. Par-delà son pessimisme évident, indissociable d’une volonté d’authenticité ethnographique, Boyz n the Hood à l’instar de ses nombreux et talentueux cousins filmiques (Juice, Friday, South Central, Poetic Justice) porte en lui l’espoir, comme peut le faire le hip-hop ou le gospel. 25 ans après, qu’en reste-t-il ? Il faut sortir des multiplexes pour le savoir et se confronter aux manifestations sociétales. Ainsi depuis 2013, Black Lives Matter (les vies noires comptent), mouvement militant pour les droits de la communauté afro-américaine, fustigeant les violences policières dont sont victimes les populations discriminées, peut se concevoir comme l’héritier de ce film-tract. Black Lives Matter, au fil des rues états-uniennes (mais aussi au Canada et au Ghana), traduit ce sentiment politique qui anime John Singleton en tant qu’auteur. Ce discours jugulant la globalité d’un cinéma nineties, synthétisé en une assertion aux accents de slogan : « les vies noires ont toujours compté« .
Clément Arbrun (Les inrocks Juin 2016)
Soirée CinéConf
jeudi 15 décembre
2022 à 20h00
Suivie d’une rencontre avec Yvelin Ducotey (Docteur en études anglophones, spécialisé en études filmiques, Université d’Angers, et coordinateur du cycle CinéConf) et Yohann Le Moigne (Maître de conférences en études américaines, Université d’Angers)
Séance organisée en partenariat avec la SFR Confluences
BOYZ'N THE HOOD
de John Singleton
avec Cuba Gooding Jr., Ice Cube, Morris Chestnut
USA - 1991 - 1H52 - VOST
Le passage de l'adolescence à l'âge d'homme pour trois amis du ghetto South Central à Los Angeles : Tre, un brillant élève qui s'est fait renvoyé de son école pour avoir déclenché une bagarre; Ricky, un athlète qui cherche à décrocher une bourse d'études pour une grande université; et son demi-frère Doughboy, plongé dans l'alcoolisme et la délinquance.
A PROPOS
Voici 25 ans déjà qu’est sorti en salles « Boyz’n’The Hood ». Son South Central sous tension, son Laurence Fishburne post-Abel Ferrara, sa B.O où Ice Cube côtoie Monie Love et Quincy Jones. Le cinéaste John Singleton est récemment revenu sur l’accueil de son film le plus estimé et l’influence de celui-ci sur le paysage culturel, au gré des décennies.
C’était la grande époque de la « hoodploitation », ou « cinéma de ghettos », un courant cinématographique où s’entrechoquaient l’iconographie gangsta, la culture reality rap et les aspérités de la chronique sociale. La hoodploitation est l’héritière du mouvement seventies de la blaxploitation, qui mettait en évidence le « black power » au gré d’icônes funky de séries B, films d’exploitation et autres figures sulfureuses (Shaft, Dolemite, le réalisateur Melvin Van Peebles, l’actrice Pam Grier) tout en décalquant le naturalisme (Mean Streets) et l’épate (Les Affranchis) de Scorsese, voire la subversion du Scarface de De Palma.
Boyz n The Hood se situe au coeur de cette vague nineties, aux côtés du Menace II Society des frères Hugues, de New Jack City et des premières oeuvres de Spike Lee. Son succès – 57 millions de dollars de recettes – en fera une oeuvre emblématique, nommée par deux fois aux Oscars, présentée à Un Certain Regard à l’édition 91 du Festival de Cannes et reconnue par la Library of Congress comme commentaire social d’utilité publique.
Boyz n The Hood, tout en mettant en scène l’oppression de la classe afro-américaine fut le vecteur de talents et de figures évocatrices. De jeunes interprètes révélés ou magnifiés, parmi lesquels figurent Cuba Gooding Jr., Ice Cube, Nia Long, ou encore Regina King. Une jeunesse qui ferait de ce mouvement une sorte de Nouvelle Vague black. Cette oeuvre est ainsi le premier long-métrage d’un auteur débutant, pourvu de ses propres mentors et qui souhaitait, en 1991, privilégier une certaine conscience sociopolitique tout en affirmant sa naissante identité d’artiste.
« J’ai l’impression de pénétrer au sein d’une machine à voyager dans le temps dès que je fais référence à toute cette époque. J’ai écrit le scénario de Boyz n the Hood quand j’avais seulement vingt ans. J’avais vu Do The Right Thing de Spike Lee au cours de l’été 89. Je suis directement tombé amoureux de Spike, il est devenu, en quelque sorte, mon grand-frère de cinéma. Je l’ai rencontré deux avants de débuter mon film de fin d’année pour l’Université de Californie du Sud. A l’école la marginalisation de la classe afroaméricaine était continuelle. On disait de moi : « Oh, il va juste devenir un autre Spike Lee » et tout ce genre de choses. Mais j’étais genre « non, je ne serai pas le prochain Spike Lee, je serai le prochain John Singleton« . Je suis donc parti de la fac en me disant que je deviendrai l’équivalent de la NBA ou le NFL pour le cinéma. Tout ce que je savais, je l’avais vu dans le ghetto. Alors je suis parti avec mes potes sur Vermont Avenue en décidant de raconter notre histoire. Tout le projet vient de là : j’essayais de bâtir ma propre identité en tant que cinéaste vivant à Los Angeles, et je concevais en une certaine partie de Los Angeles une partie de mon identité »
Boyz n The Hood, le Michael Jordan du film de banlieues ? Il aura en tout cas la notoriété populaire propre au sport d’équipe, sachant toucher les publics, peu importe l’origine sociale du spectateur. Ce cinéma à la fois communautaire et populaire définit la nécessité d’attribuer à une culture spécifique ses moyens d’expression les plus retentissants, une liberté qui, comme à travers les clips de hip-hop diffusés sur MTV, se voit permise par la médiatisation. « Quand vous êtes au plus près des gens, vous obtenez vos histoires. Tout le monde a une histoire à raconter mais peu ont la possibilité de le faire. Je pensais pouvoir être le porte-parole de ces personnes […] Je me sens comme Ernest Hemingway, qui a voyagé à travers divers endroits tout en écrivant sur ses expériences. J’aime avoir la possibilité de faire ça, j’aime écouter les gens » raconte le cinéaste.
En phase avec le mood musical d’une décennie (les sonorités urbano-fiévreuses du Wu-Tang Clan, du N.W.A, de Jay-Z et de Public Enemy) la hoodploitation s’inscrivait dans la droite lignée idéologique de Spike Lee et de son éloquent Do The Right Thing. Pour Singleton, le black cinema actuel est désormais à bout de souffle et la véhémence qui lui était propre semble être morte avec le regretté Biggie Smalls.
« A l’heure actuelle, le cinéma afro-américain se trouve dans une situation morne et triste. Peu importe combien de thune ces films ont rapporté ou le nombre de hits relatifs à la black culture : ces oeuvres ne possèdent pas la moindre conscience culturelle. Les films n’ont pas tous à faire un état des lieux, être engagés, c’est vrai – mes films n’ont pas vocation de prêche, ce sont avant tout des divertissements. Mais quand le cinéma a un certain poids culturel, alors il divertit. Je ne veux dénigrer personne. Mais j’essaie toujours de m’accorder à ce que Spike Lee privilégiait quand il n’en était seulement qu’à ses débuts derrière la caméra. Il semblait alors nous dire à tous : « Ecoutez, nous pouvons imposer notre propre langage à travers les films de la black culture. Il peut se créer une esthétique de cinéma afro-américain, quelque chose d’unique : le black american cinema«
Plus que le Spike Lee des années 80, véritable porte-parole dont les galvanisants Nola Darling n’en fait qu’à sa tête, School Daze et Jungle Fever furent tout aussi influents concernant le cinéma de Singleton, il faut pour envisager à sa juste valeur l’identité de ce gangsta movie en revenir selon le cinéaste aux classiques de la culture italienne et italo-américaine, soit une certaine histoire de la cinéphilie et une visualisation de l’objectif comme miroir porté sur le réel.
« Si les gens ne se font pas entendre, alors c’est comme s’ils n’existaient pas. Quand j’étais en école de cinéma, j’ai découvert Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica et Rome, ville Ouverte de Roberto Rossellini, deux films italiens post-Seconde Guerre Mondiale, et j’ai pu constater par la suite combien des cinéastes comme Scorsese et Coppola étaient influencés par ces films, des cinéastes qui n’hésitaient pas à mettre en scène les spécificités de la culture italienne. C’est précisément ce que je voulais faire avec le black american cinema. Si vous êtes blanc, il y a certaines blagues que vous ne comprendrez pas en visionnant le film, mais de manière plus universelle, en tant qu’être humain, vous comprendrez forcément ces personnages. C’est sur cela que je suis parti avec Boyz N the Hood. Et c’est très compliqué de développer ça au sein d’un système qui marginalise les artistes de couleur.
La violence du film est-elle celle d’une oraison funèbre ? C’est tout du moins l’esprit d’une légende de la black culture – un « Rap God » – qui plane sur ce film où la Foi en Dieu fait justement office de thématique majeure. Le martyr en question a pour nom 2Pac, celui-là même qui affirmait que, malgré la chaleur de l’asphalte et les fusillades, Life Goes On. En se remémorant l’artiste assassiné, Singleton traite d’un talentueux jeune homme qui, comme lui, avait à peine 22 ans en ce temps-là, une période d’émotions intenses partagée entre dénonciation salvatrice et lucidité nihiliste.
« Tupac n’était pas du tout conscient du don qu’il avait. Personne ne pouvait savoir qu’il allait évoluer et devenir un vrai leader, mais il possédait clairement un potentiel. Je crois que c’est pour cela qu’il n’est plus avec nous en ce moment. C’était un gamin de 21 ans qui dénonçait à la télévision tout ce qui foirait dans ce pays, socialement et multi-ethniquement. Il luttait fortement pour les gens de couleur et le respect des droits de l’homme. Il était emblématique de notre génération, celle qui scandait : « nous ne voulons pas d’un Messie Black, nous voulons juste nous en sortir«
Malgré tout, ne nous y trompons pas. Par-delà son pessimisme évident, indissociable d’une volonté d’authenticité ethnographique, Boyz n the Hood à l’instar de ses nombreux et talentueux cousins filmiques (Juice, Friday, South Central, Poetic Justice) porte en lui l’espoir, comme peut le faire le hip-hop ou le gospel. 25 ans après, qu’en reste-t-il ? Il faut sortir des multiplexes pour le savoir et se confronter aux manifestations sociétales. Ainsi depuis 2013, Black Lives Matter (les vies noires comptent), mouvement militant pour les droits de la communauté afro-américaine, fustigeant les violences policières dont sont victimes les populations discriminées, peut se concevoir comme l’héritier de ce film-tract. Black Lives Matter, au fil des rues états-uniennes (mais aussi au Canada et au Ghana), traduit ce sentiment politique qui anime John Singleton en tant qu’auteur. Ce discours jugulant la globalité d’un cinéma nineties, synthétisé en une assertion aux accents de slogan : « les vies noires ont toujours compté« .
Clément Arbrun (Les inrocks Juin 2016)