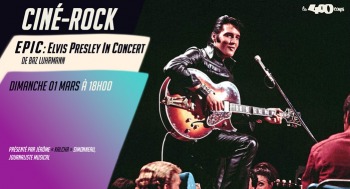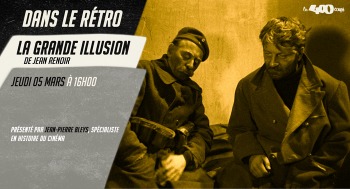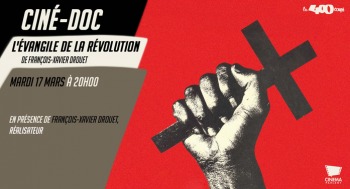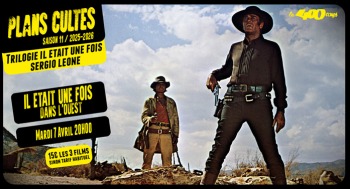ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS
A hauteur d’orpheline
Après la mort de ses parents, Frida, 6 ans, est confiée à sa tante et à son oncle qui vivent à la campagne avec leur petite fille de 3 ans. Une telle histoire aurait pu aisément donner lieu à un éprouvant tire-larmes mais, peut-être parce qu’elle s’inspire de sa propre enfance, Carla Simón (dont c’est le premier long métrage) fait au contraire preuve d’une très belle retenue. En se tenant à la hauteur de la fillette, elle se souvient que le point de vue de l’enfant n’est pas forcément le plus pathétique, il peut être au contraire le plus distant, le plus détaché. La cinéaste se centre sur ce moment, qui dure ici le temps d’un été, où l’orpheline n’a pas encore assimilé et formulé son malheur. Elle voit que les adultes se cachent pour pleurer, elle sent qu’elle gêne parfois ceux qui font de leur mieux pour la traiter comme leur fille, elle ne sait pas encore distinguer le provisoire du définitif.
Notre perception et notre savoir évoluent à son rythme, par bribes, de manière souvent indirecte. Jusqu’au moment où elle pose des questions sur la mort de sa mère, auxquelles sa tante répond simplement. Alors l’émotion et les larmes adviennent enfin, belles et libératrices. Et le film peut s’arrêter.
Pour Frida, qui vit à Barcelone, cet été marque aussi sa découverte de la nature. La mise en scène sensorielle de Carla Simón la rend très présente à l’image comme au son, dans ce qu’elle peut avoir de somptueux et de sensuel mais aussi d’oppressant et de mortifère. Ce monde indifférent qui l’entoure permet à la fillette d’appréhender la mort dans ce qu’elle a de plus matériel et cru, loin de la magie enfantine ou de la religiosité de ses grands-parents. Le film n’est cependant pas un précis de psychologie enfantine, il s’agit surtout de confronter la douleur du souvenir, la mélancolie des blessures premières, au présent de la perception immédiate, particulièrement intense chez l’enfant pour qui tout est nouveau.
Le film doit aussi beaucoup à ses petites actrices, assez formidables. Leur justesse est notamment rendue possible par de longs plans-séquences où elles semblent oublier la caméra pour éprouver l’instant comme l’éprouvent leurs personnages. La dignité et le regard intense de Laia Artigas (Frida) rappellent ceux d’Ana Torrent, la petite fille de l’Esprit de la ruche (1973) de Victor Erice et de Cría cuervos (1976) de Carlos Saura (un hommage est d’ailleurs rendu à ce film dans la scène où Frida se déguise en femme, pour jouer à la maman avec sa cousine).
Car c’est bien à cette famille de films qu’appartient Eté 93, ceux où l’enfance n’est pas abordée comme un sujet que l’on scruterait depuis un savoir d’adulte, mais comme une manière de percevoir et de comprendre le monde. Une forme de distance avec les événements, aussi intimes et dramatiques soient-ils.
Marcos Uzal (Libération)
Soirée rencontre
jeudi 4 octobre
2018 à 20h00
suivi d'un débat avec Jocelyne Turgis, psychologue, membre de l’association de la Cause Freudienne et animée par Dominique Fraboulet, membre de l’association de la Cause Freudienne.
ÉTÉ 93
de Carla Simon
avec Laia Artigas, Paula Blanco, Bruna Cusí
ESPAGNE - 2017 - 1h34 - VOST - Berlin 2017
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et part vivre à la campagne chez son oncle et sa tante et leur petite fille de 3 ans. Le temps d'un été, l'été 93, Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à l'aimer comme leur propre fille.
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-prochainement/ete-93.html
A PROPOS
A hauteur d’orpheline
Après la mort de ses parents, Frida, 6 ans, est confiée à sa tante et à son oncle qui vivent à la campagne avec leur petite fille de 3 ans. Une telle histoire aurait pu aisément donner lieu à un éprouvant tire-larmes mais, peut-être parce qu’elle s’inspire de sa propre enfance, Carla Simón (dont c’est le premier long métrage) fait au contraire preuve d’une très belle retenue. En se tenant à la hauteur de la fillette, elle se souvient que le point de vue de l’enfant n’est pas forcément le plus pathétique, il peut être au contraire le plus distant, le plus détaché. La cinéaste se centre sur ce moment, qui dure ici le temps d’un été, où l’orpheline n’a pas encore assimilé et formulé son malheur. Elle voit que les adultes se cachent pour pleurer, elle sent qu’elle gêne parfois ceux qui font de leur mieux pour la traiter comme leur fille, elle ne sait pas encore distinguer le provisoire du définitif.
Notre perception et notre savoir évoluent à son rythme, par bribes, de manière souvent indirecte. Jusqu’au moment où elle pose des questions sur la mort de sa mère, auxquelles sa tante répond simplement. Alors l’émotion et les larmes adviennent enfin, belles et libératrices. Et le film peut s’arrêter.
Pour Frida, qui vit à Barcelone, cet été marque aussi sa découverte de la nature. La mise en scène sensorielle de Carla Simón la rend très présente à l’image comme au son, dans ce qu’elle peut avoir de somptueux et de sensuel mais aussi d’oppressant et de mortifère. Ce monde indifférent qui l’entoure permet à la fillette d’appréhender la mort dans ce qu’elle a de plus matériel et cru, loin de la magie enfantine ou de la religiosité de ses grands-parents. Le film n’est cependant pas un précis de psychologie enfantine, il s’agit surtout de confronter la douleur du souvenir, la mélancolie des blessures premières, au présent de la perception immédiate, particulièrement intense chez l’enfant pour qui tout est nouveau.
Le film doit aussi beaucoup à ses petites actrices, assez formidables. Leur justesse est notamment rendue possible par de longs plans-séquences où elles semblent oublier la caméra pour éprouver l’instant comme l’éprouvent leurs personnages. La dignité et le regard intense de Laia Artigas (Frida) rappellent ceux d’Ana Torrent, la petite fille de l’Esprit de la ruche (1973) de Victor Erice et de Cría cuervos (1976) de Carlos Saura (un hommage est d’ailleurs rendu à ce film dans la scène où Frida se déguise en femme, pour jouer à la maman avec sa cousine).
Car c’est bien à cette famille de films qu’appartient Eté 93, ceux où l’enfance n’est pas abordée comme un sujet que l’on scruterait depuis un savoir d’adulte, mais comme une manière de percevoir et de comprendre le monde. Une forme de distance avec les événements, aussi intimes et dramatiques soient-ils.
Marcos Uzal (Libération)