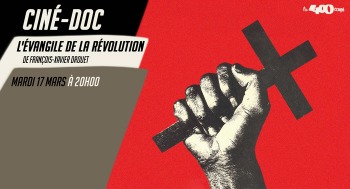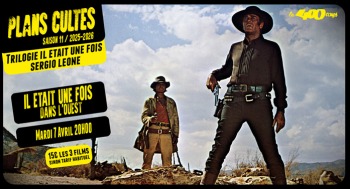ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS
« Moon River/ Wider than a mile/ I’m crossing you in style/ Someday... » De Frank Sinatra à REM, quel musicien n’a jamais entonné la chanson qu’Henry Mancini composa spécialement pour le film de son ami Blake Edwards ? N’oublions pas pourtant que ce fut la voix délicate d’Audrey Hepburn et ses longs doigts maigres grattant la guitare, qui firent de « Moon River » le tube que l’on sait. Quand le réalisateur des comédies les plus loufoques de son temps (La Panthère rose, La Party) rencontre la comédienne la plus élégante de tous les temps, cela donne un chef-d’œuvre aussi doux qu’un verre de champagne et aussi amer qu’un jour de pluie qui n’en finit pas.
« C’est l’histoire d’une fille qui vit toute seule et qui est très effrayée. » Voici comment Paul Varjak, jeune écrivain en panne d’inspiration (et accessoirement gigolo d’une femme très riche), décrit sa jolie voisine un peu timbrée, Holly Golightly – Lula Mae Barnes de son vrai nom. En apparence, Holly est pourtant une femme qui respire le bonheur : elle ne cesse d’ailleurs de répéter à quel point elle est « divinement heureuse » à qui veut bien l’entendre. Ses journées défilent paisiblement, du verre de champagne au réveil – jamais avant midi, sauf quand elle doit se rendre à Sing Sing pour récupérer le bulletin météo d’un parrain de la mafia – aux nuits d’orgie dans son appartement. On ne saura jamais trop quelle activité permet à Holly de subvenir à ses besoins, mais il est permis de croire que, lorsque des gentlemen lui donnent 50 dollars pour aller se repoudrer dans les toilettes des night-clubs, ils n’attendent pas seulement d’elle qu’elle leur fasse la conversation.
Le bonheur de Holly est évidemment trop bruyant pour être honnête : sa façon de parler sans cesse de tout et de rien est aussi une manière pour elle d’éviter le silence, d’éviter de se retrouver seule avec ses pensées noires, de combattre ses envies de mourir par des petits riens, comme par exemple un petit-déjeuner à l’aube, devant la vitrine du bijoutier Tiffany’s. Excentrique, glamour, timbrée, décalée, Holly est un véritable personnage de cinéma, comme il n’en existe pas (ou si peu) dans la vie réelle. Ce qui ne l’empêche pas d’être aussi très humaine, surtout dans les moments où elle baisse sa garde, où elle ne contrôle plus ses réactions. Holly, au fond, est une toute petite fille pas encore sortie de l’enfance, mais qui en a vu de toutes les couleurs et n’a plus l’intention – pense-t-elle – de se laisser marcher sur les pieds. Pour s’assurer d’être toujours libre de s’envoler plus haut, elle cherche à épouser un homme riche pour qui elle n’éprouve pas d’amour : mais ce désir de liberté trop intense ne cache-t-il pas une prison plus sournoise encore ?
À l’instar de la nouvelle de Truman Capote dont Diamants sur canapé est l’adaptation, le film de Blake Edwards n’a qu’un seul personnage : Holly. Les autres, au fond, n’existent que par et à travers elle, tous fascinés à des niveaux divers par son extravagance. Paul Varjak, dont le point de vue sert de déroulement à l’histoire, n’est pas le seul à voir les fêlures de sa jeune voisine ; du moins est-il le seul à ne pas chercher à en profiter. Holly est comme un oiseau dont on aurait ouvert la cage et qui s’en échapperait pour mieux y retourner, incapable de s’adapter au monde extérieur et aux « salauds » qui le peuplent. C’est en concentrant la quasi-totalité de ses scènes à l’intérieur de l’immeuble où habite Holly que Blake Edwards montre le mieux la façon dont la jeune femme s’est volontairement enfermée dans une vie qu’elle fait semblant d’avoir consciemment choisie. Ses brèves échappées à l’extérieur l’étouffent, comme si son corps habitué à la pollution ne pouvait supporter l’air pur, comme si son cœur devenu sec par habitude était devenu imperméable à l’amour.
Pour interpréter le personnage de Holly, Blake Edwards avait d’abord pensé à Marilyn (qui venait de terminer Les Désaxés). On imagine ce que la tristesse désespérée du sex-symbol le plus célèbre de tous les temps, qui devait disparaître en 1962, un an après la sortie du film, aurait pu apporter au rôle. Mais en se tournant finalement vers miss Hepburn, Blake Edwards pensait-il que la comédienne allait y trouver le rôle de sa vie ? Difficile d’imaginer qu’Holly Golightly puisse être incarnée par quelqu’un d’autre, tant Audrey Hepburn a donné au personnage : de sa fragilité de brindille que le moindre coup de vent semble pouvoir emporter, mais aussi de son élégance raffinée, qui lui permet de dire les pires horreurs sans avoir jamais l’air vulgaire, et de porter une robe Givenchy sur un trottoir new-yorkais comme s’il n’y avait rien de plus normal dans la vie. Holly Golightly, c’est elle.
Si Diamants sur canapé est sans aucun doute le film le plus réussi de Blake Edwards, c’est qu’à l’inverse d’œuvres comme La Party ou La Panthère rose, le cinéaste ne filme pas une succession de gags burlesques. Il abandonne en quelque sorte le comique « Laurel et Hardy » pour se tourner vers un comique plus mûr, et plus "tragique" aussi : celui de Chaplin, mi-Auguste, mi-clown blanc. Si les gags fusent, tout autant dans les dialogues que les situations (rythmées par la musique jazz de Henry Mancini), l’impression générale est plutôt celle d’un film doux-amer que d’une comédie : Diamants sur canapé reste au fond sur un goût d’inachevé, comme dans le happy-end final (ressort scénaristique très hollywoodien qui n’est pas dans la nouvelle originale). Holly Golightly réussira-t-elle à être heureuse ou l’amour de Paul finira-t-il, lui aussi, par l’étouffer ? Ses lunettes noires cesseront-elles un jour de cacher ses larmes ? En est-il vraiment fini des petits-déjeuners chez Tiffany’s ?
Ophélie Wiel (Critikat)
Ciné Classique
dimanche 4 décembre
2016 à 17h45
présenté par Sébastien Farouelle, professeur en cinéma audiovisuel
Soirée organisée en collaboration avec Cinéma Parlant
DIAMANTS SUR CANAPE
de Blake Edwards
avec Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal
USA - 1961 - 1h55 - VOST - Réédition - Version restaurée
Une croqueuse de diamants n'a qu'une idée en tête : épouser un homme riche. Pourtant son voisin, écrivain, s'intéresse à elle. La belle Holly n'a d'yeux que pour un truand pour qui elle va en toute innocence faire le messager… Interrogée par la police, elle perdra son " fiancé "! Il n'en faudra pas plus pour que son voisin écrivain tente de la consoler… Sera-t-elle séduite par cet homme charmant… mais fauché !
http://www.splendor-films.com/item/364
A PROPOS
« Moon River/ Wider than a mile/ I’m crossing you in style/ Someday... » De Frank Sinatra à REM, quel musicien n’a jamais entonné la chanson qu’Henry Mancini composa spécialement pour le film de son ami Blake Edwards ? N’oublions pas pourtant que ce fut la voix délicate d’Audrey Hepburn et ses longs doigts maigres grattant la guitare, qui firent de « Moon River » le tube que l’on sait. Quand le réalisateur des comédies les plus loufoques de son temps (La Panthère rose, La Party) rencontre la comédienne la plus élégante de tous les temps, cela donne un chef-d’œuvre aussi doux qu’un verre de champagne et aussi amer qu’un jour de pluie qui n’en finit pas.
« C’est l’histoire d’une fille qui vit toute seule et qui est très effrayée. » Voici comment Paul Varjak, jeune écrivain en panne d’inspiration (et accessoirement gigolo d’une femme très riche), décrit sa jolie voisine un peu timbrée, Holly Golightly – Lula Mae Barnes de son vrai nom. En apparence, Holly est pourtant une femme qui respire le bonheur : elle ne cesse d’ailleurs de répéter à quel point elle est « divinement heureuse » à qui veut bien l’entendre. Ses journées défilent paisiblement, du verre de champagne au réveil – jamais avant midi, sauf quand elle doit se rendre à Sing Sing pour récupérer le bulletin météo d’un parrain de la mafia – aux nuits d’orgie dans son appartement. On ne saura jamais trop quelle activité permet à Holly de subvenir à ses besoins, mais il est permis de croire que, lorsque des gentlemen lui donnent 50 dollars pour aller se repoudrer dans les toilettes des night-clubs, ils n’attendent pas seulement d’elle qu’elle leur fasse la conversation.
Le bonheur de Holly est évidemment trop bruyant pour être honnête : sa façon de parler sans cesse de tout et de rien est aussi une manière pour elle d’éviter le silence, d’éviter de se retrouver seule avec ses pensées noires, de combattre ses envies de mourir par des petits riens, comme par exemple un petit-déjeuner à l’aube, devant la vitrine du bijoutier Tiffany’s. Excentrique, glamour, timbrée, décalée, Holly est un véritable personnage de cinéma, comme il n’en existe pas (ou si peu) dans la vie réelle. Ce qui ne l’empêche pas d’être aussi très humaine, surtout dans les moments où elle baisse sa garde, où elle ne contrôle plus ses réactions. Holly, au fond, est une toute petite fille pas encore sortie de l’enfance, mais qui en a vu de toutes les couleurs et n’a plus l’intention – pense-t-elle – de se laisser marcher sur les pieds. Pour s’assurer d’être toujours libre de s’envoler plus haut, elle cherche à épouser un homme riche pour qui elle n’éprouve pas d’amour : mais ce désir de liberté trop intense ne cache-t-il pas une prison plus sournoise encore ?
À l’instar de la nouvelle de Truman Capote dont Diamants sur canapé est l’adaptation, le film de Blake Edwards n’a qu’un seul personnage : Holly. Les autres, au fond, n’existent que par et à travers elle, tous fascinés à des niveaux divers par son extravagance. Paul Varjak, dont le point de vue sert de déroulement à l’histoire, n’est pas le seul à voir les fêlures de sa jeune voisine ; du moins est-il le seul à ne pas chercher à en profiter. Holly est comme un oiseau dont on aurait ouvert la cage et qui s’en échapperait pour mieux y retourner, incapable de s’adapter au monde extérieur et aux « salauds » qui le peuplent. C’est en concentrant la quasi-totalité de ses scènes à l’intérieur de l’immeuble où habite Holly que Blake Edwards montre le mieux la façon dont la jeune femme s’est volontairement enfermée dans une vie qu’elle fait semblant d’avoir consciemment choisie. Ses brèves échappées à l’extérieur l’étouffent, comme si son corps habitué à la pollution ne pouvait supporter l’air pur, comme si son cœur devenu sec par habitude était devenu imperméable à l’amour.
Pour interpréter le personnage de Holly, Blake Edwards avait d’abord pensé à Marilyn (qui venait de terminer Les Désaxés). On imagine ce que la tristesse désespérée du sex-symbol le plus célèbre de tous les temps, qui devait disparaître en 1962, un an après la sortie du film, aurait pu apporter au rôle. Mais en se tournant finalement vers miss Hepburn, Blake Edwards pensait-il que la comédienne allait y trouver le rôle de sa vie ? Difficile d’imaginer qu’Holly Golightly puisse être incarnée par quelqu’un d’autre, tant Audrey Hepburn a donné au personnage : de sa fragilité de brindille que le moindre coup de vent semble pouvoir emporter, mais aussi de son élégance raffinée, qui lui permet de dire les pires horreurs sans avoir jamais l’air vulgaire, et de porter une robe Givenchy sur un trottoir new-yorkais comme s’il n’y avait rien de plus normal dans la vie. Holly Golightly, c’est elle.
Si Diamants sur canapé est sans aucun doute le film le plus réussi de Blake Edwards, c’est qu’à l’inverse d’œuvres comme La Party ou La Panthère rose, le cinéaste ne filme pas une succession de gags burlesques. Il abandonne en quelque sorte le comique « Laurel et Hardy » pour se tourner vers un comique plus mûr, et plus "tragique" aussi : celui de Chaplin, mi-Auguste, mi-clown blanc. Si les gags fusent, tout autant dans les dialogues que les situations (rythmées par la musique jazz de Henry Mancini), l’impression générale est plutôt celle d’un film doux-amer que d’une comédie : Diamants sur canapé reste au fond sur un goût d’inachevé, comme dans le happy-end final (ressort scénaristique très hollywoodien qui n’est pas dans la nouvelle originale). Holly Golightly réussira-t-elle à être heureuse ou l’amour de Paul finira-t-il, lui aussi, par l’étouffer ? Ses lunettes noires cesseront-elles un jour de cacher ses larmes ? En est-il vraiment fini des petits-déjeuners chez Tiffany’s ?
Ophélie Wiel (Critikat)